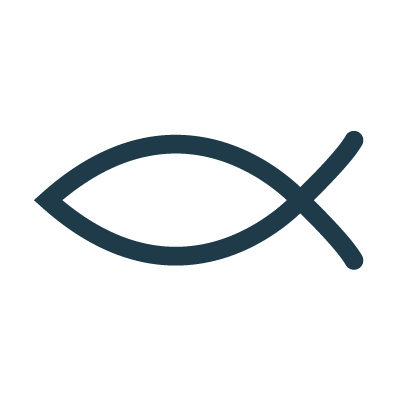Projet d’avant-propos pour une publication et une traduction en français d’un livre que j’ai écrit en anglais en 2013, Seven Years in Utopia, et qui fut auto-publié en e-book sur Amazon. Une « oeuvre de jeunesse » inachevée qui mériterait bien une belle édition papier un jour et d’être complété d’une première partie un peu sur le modèle de l’Utopie de Thomas More.
L’idée de ce livre est partie d’une joke de bureau tout à fait potache, commise après un long lunch trop arrosé dans quelque gastro pub du cœur de Londres, avec S., un ancien collègue banquier atypique devenu un cher ami et amateur comme moi d’art contemporain subversif : l’iconographie corporate stéréotypée ressemble étrangement au « réalisme socialiste », qui n’a de fait rien de particulièrement réaliste dans sa représentation idéalisée et glorifiée des travailleurs et des leaders communistes.


Mais l’idée de pleinement exploiter cette private joke et de la transformer en livre est née un peu plus tard par une nuit de pleine lune. Durant l’été 2012, dans la minuscule cuisine de l’appartement uber-coloré d’une artiste berlinoise que j’avais rencontré complètement par hasard quelques mois plus tôt dans un café où elle était serveuse. Un appartement quelque part dans la partie Est de la ville, qu’elle m’avait sous-loué le temps de suivre des cours d’allemand pour débutants au Goethe Institut. J’y fis la connaissance d’E., ma prof d’allemand, elle aussi artiste, avec qui j’eu une petite romance fort amusante et tout à fait platonique, et qui fut ma Muse.

Mais, une nouvelle fois, j’ai en fait commencé à écrire ce livre trois ans auparavant, dans ma garçonnière de South Kensington, sans avoir la moindre idée que ce que j’écrivais alors ferait un jour partie d’un livre. Ce livre fut ainsi très largement composé pendant mon séjour à Londres de 2006 à 2013. Il n’appartient pas pour autant au genre du récit de voyage. Le monde qu’il décrit, que j’ai baptisé Processia – avec pour capitale « Nondon » ou Nondres – est tout à fait imaginaire. Du moins tout aussi imaginaire qu’une œuvre de fiction puisse l’être.
Il est néanmoins vrai que si je choisis de quitter Paris en 2006 pour m’expatrier à Londres et travailler à la City, c’est que cette ville m’apparaissait alors comme une véritable utopie capitaliste « réellement existante », dont je désirais ardemment faire partie. Ville-monde cosmopolite accueillant avec une grande tolérance toutes les cultures de la planète, à l’excitante vie sociale et culturelle, pleine d’énergie positive et gentiment hédoniste, où il était possible d’être pleinement soi sans être jugé, et qui en plus semblait promettre un confortable enrichissement aux plus travailleurs et aux plus méritants. Je le croyais vraiment, de tout mon cœur.


Diplômé d’HEC en 1995 j’avais choisi comme beaucoup de mes « camarades » (c’est ainsi que nous nous appelons) de travailler dans la finance, ni par vocation, ni par une faim démesurée de richesses, mais tout simplement parce que cela me paraissait être un sujet intellectuellement stimulant et accessoirement prestigieux. Issu d’un milieu comme on dit modeste (mon père était ouvrier menuisier, ma mère était au foyer à se consacrer à mon frère polyhandicapé), ayant grandi dans une cité des quartiers nord de Marseille et avec pour grands-pères des révolutionnaires Républicains espagnols exilés en France (l’un socialiste, l’autre anarchiste), mon parcours scolaire puis professionnel allait radicalement à l’encontre de toutes les bonnes vieilles théories sociologiques, où dominent l’idée d’un déterminisme social implacable.
C’est pourtant la sociologie que j’entrepris d’étudier à partir de l’automne 2009 en cours du soir dans une université londonienne spécialisée en formation continue, le Birkbeck College. Drôle de hobby pour un banquier d’affaires le jour. Je ne souviens plus très bien qu’elle fut l’enchaînement de mes idées, mais je crois que tout a commencé par une publicité lue dans le tube, comme quoi en substance reprendre des études à Birkbeck allait changer votre vie. Jamais je n’airai lu de publicité moins trompeuse, car ma vie en a été entièrement bouleversée et mise sur une toute autre orbite que celle à laquelle mes études à HEC m’avait formaté.


Pourquoi ne pas avoir pris des cours du soir en littérature ou en philosophie ? J’étais après tout le cas typique du littéraire frustré qui avait rêvé un temps de pareils sujets d’étude dans une romantique adolescence, mais qui avait dû se résoudre à des études beaucoup plus alimentaires par la force des choses. Et puis la sociologie a priori ça ne sert strictement à rien : les sociologues professionnels ne courent pas les rues.
Je crois que dans ma décision il y avait une certaine fatigue d’une certaine culture prêt-à-porter, me conduisant à flâner d’expositions branchées en salles de cinéma de pseudo-auteurs, à lire « comme tout le monde » du Alain de Botton (très en vogue à l’époque) ou les platitudes vociférantes d’un Michel Onfray. J’avais besoin de quelque chose de plus hardcore conceptuellement.

Il y avait aussi une profonde envie de comprendre la société britannique, qui me semblait annoncer le futur prévisible de nos sociétés consuméristes, gestionnarisées et mondialisées. Il y avait enfin sans doute aussi à la fois le besoin de faire sens et de m’extraire du marasme financier dans lequel je baignais quotidiennement dans la banque sinistrée qui m’employait à l’époque : la Royal Bank of Scotland qui avait englouti des sommes pharamineuses aux frais du contribuable dans le sillage de la faillite de Lehman Brothers et de l’éclatement de la bulle des subprimes en 2008. Une banque qui après un illustre passé, était devenue, au moment où je l’ai connu, une caricature de ce qu’il y a de pire dans le monde corporate en matière de politique interne, de prises de décisions ineptes et de coups bas en tous genres.


Et puis, loin de toutes ambitions conceptuelles, il y a eu A, ma Muse primordiale. A je l’ai passionnément aimée. Je l’ai rencontrée complètement par hasard dans un avion peu après mon arrivée à Londres. Femme d’une rare beauté, métis anglo-danoise, d’une intelligence pétillante et d’une conversation si excitante, femme d’affaires redoutable (je trouvais ça so sexy) qui conseillait en spin doctor les plus grands CEO de la terre sur leur communication financière, elle me fit comprendre de l’intérieur le fonctionnement de la société britannique et les rouages de la City.
Pour elle qui avait dix ans de plus que moi, j’étais un peu son French lover, avait qui elle aimait bien à l’occasion s’amuser. C’est sans doute un peu pour l’impressionner intellectuellement que je me suis mis à faire de la sociologie. Je pense à elle encore parfois, elle qui partit si jeune rejoindre les cieux en 2013 d’un affreux cancer du pancréas. Mon intime conviction est que c’est le métier excessivement stressant qu’elle exerçait – il fallait mentir de manière éhontée à longueur de journée – qui l’a rongée à petit feu de l’intérieur.


L’intitulé du cours de sociologie sur un semestre que j’entrepris ne laissait aucunement présager un changement existentiel radical : everyday-life sociology, ou sociologie de la vie quotidienne. Mon prof de sociologie, F., était absolument génial et fascinant et s’avéra avoir pour ses élèves de grandes ambitions : nous faire écrire des papiers académiques aux meilleurs standards de la recherche universitaire.
Ces ambitions s’avérèrent stressantes pour beaucoup de mes camarades de classe, mais quant à moi me stimulèrent profondément et je me pris tout de suite au jeu. Je découvris alors ce trésor intellectuel que constituent les publications scientifiques, à des années-lumière de la médiocrité de ce qui se dit dans les talk-shows ou se lit dans les grandes surfaces culturelles. Je découvris une myriade d’intellectuels universitaires, qui patiemment, avec rigueur et dans l’ombre, exploraient tous les sujets possibles et imaginables.


Le cours était évalué par une courte recension d’un ouvrage à choisir dans une bibliographie et un essai plus long. Ayant autour de la vingtaine beaucoup fréquenté les boites de nuit, je choisis de faire une recension d’un ouvrage de Sarah Thornton, Club Cultures.
Tiré d’une thèse, c’était un ouvrage tout ce qu’il y a de plus obscur et confidentiel. C’était une analyse sociologique du monde des boites de nuit techno londoniennes du début des années 90, empruntant beaucoup aux idées de Bourdieu en matière de capital culturel. Ce texte me passionna et j’en fis une recension en mettant beaucoup de cœur à l’ouvrage. Elle enchanta mon prof, qui m’avoua autour d’une amicale pinte de bière avoir été totalement renversé par sa lecture. C’était extrêmement flatteur, bien évidemment, et ses encouragements firent aussi de F. une Muse tout à fait exceptionnelle.


Mais les relations avec cette Muse s’avérèrent vite compliquées et pour le moins « dialectiques ». Complètement novice, je n’avais pas en effet du tout décrypté son marxisme, qui pourtant n’avait rien de subliminal. Lors d’un cours je me mis à parler à tort et à travers sur Marx, un peu sur le thème « il n’a strictement rien compris, il s’est complètement planté ». Ce crime de lèse-majesté le mit dans une rage folle, ce qui m’attrista beaucoup.

Pour tenter de le reconquérir je me mis à étudier Marx à fond, mais rien n’y fit, il me garda toujours, de manière assez capricieuse je dois dire, une certaine rancune. Au deuxième semestre, j’écrivis un papier sur Marx, papier qui me semble tout à fait honorable et tout à fait respectueux de l’homme et de ses idées. Je reçus, pour ma plus grande déception, une note tout à fait médiocre, qui me dégoûta de ses cours et je n’y remis plus les pieds. Mais évidemment le virus de l’écriture sociologique m’avait été inoculé et j’allais continuer à écrire de manière indépendante d’autres choses, en prenant de plus en plus de liberté par rapport au style académique parfois un peu trop corseté.
De plus en plus dévoré par la passion de l’écriture et écœuré par ce que j’observais dans le monde corporate qui était le mien alors, je décide à l’automne 2011 de claquer la porte de ma banque avec le très vague plan d’écrire un livre, sans trop savoir lequel. Ce sera finalement un an plus tard Seven Years in Utopia, écrit dans mon anglais idiosyncratique, et auto-publié en format électronique sur Amazon, faute de mieux, et sous le pseudonyme de Francois Cerrand. Titre quelque peu ironique, puisqu’il s’agit au fond de ce qu’il est convenu d’appeler, à tort ou à raison, une dystopie.

Il serait tentant dans cet avant-propos de décrire davantage le processus créatif complètement expérimental, aléatoire et sérendipien qui fut le mien, ou de m’efforcer d’expliciter le sens profond que je vois dans ce texte. Je préfère laisser, comme il se doit, libre cours à l’imagination et au bienveillant jugement de mes lectrices et de mes lecteurs.
Ce texte dans sa version anglaise originale a été lu par un nombre très limité de personnes, essentiellement des amies et des amis et quelques universitaires. Il fut lors de sa publication un complet flop commercial. Je me suis souvent consolé par le fait que le processus d’écriture fut en soi une véritable aventure riche en rencontres et très formatrice, mais aussi parce que certains de mes lectrices et lecteurs who got it m’ont sincèrement dit l’avoir trouvé très divertissant. De fait ce livre, d’une veine résolument satirique et pamphlétaire, n’est pas à prendre (trop) au sérieux. Et en guise de disclaimer, les diverses opinions qui y sont émises n’appartiennent qu’à mon héros, Winston Hythlodono, et ne sont aucunement les miennes. Ou si peu.
Comme me le fit remarquer un de mes chers amis, ce livre est un peu un « Objet Littéraire Non Identifié ». Il appartient certainement au registre de la fiction, mais n’est pourtant pas un roman, genre dont je ne me sens pas à vrai dire très proche et pour lequel je ne me sens guère compétent. S’il s’efforce de mobiliser un certain nombre de références bibliographiques sérieuses (et à l’occasion imaginaires), il n’est pas non plus une essai ou une collection d’essais, se voulant à juste titre sérieux. Si mon séjour à Londres et à sa City l’a grandement inspiré, il n’appartient pas pour autant au genre autobiographique. Il y a peut-être à la rigueur un peu d’autofiction, genre dont j’ignorais complètement l’existence alors.

Pendant dix ans ce texte est resté à mes yeux essentiellement une œuvre de jeunesse, qui avait le mérite d’exister. Or précisément je me suis finalement rendu compte que sous son fantomatique format électronique auto-publié elle n’existait pas vraiment. Il serait tout à fait pompeux de présenter cet ouvrage comme une « écriture nouvelle » – « écriture expérimentale éphémère » plutôt – mais il semble aujourd’hui que de par sa singularité même, pour ne pas dire sa bizarrerie, il mérite de « réellement exister » sous la forme d’un beau livre incarné avec du vrai papier dedans.
A l’heure du consumérisme culturel et jetable de masse, où le livre est devenu de plus en plus marchandisé et produit en série comme du « contenu », sa publication par un éditeur digne de ce nom et audacieux serait à mes yeux une lueur d’espoir quant à la résilience de la liberté d’expression créative.
Traduire ce texte en français, écrit originellement dans un anglais tout ce qu’il y a de plus baroque, s’est avéré un exercice excessivement difficile. Traduire, c’est comme on le sait bien trahir. Dans la mesure où je me serais trahi moi-même, je suppose que ce n’est pas bien grave. Pour trouver l’inspiration dans cette tâche qui m’a longtemps rebuté, j’ai traduit Seven Years in Utopia durant les nuits de pleine lune de 2026. Je me suis efforcé de trahir le moins possible le ton très particulier, et par moment tout à fait impertinent pour ne pas dire insupportable, de mon héros Winston.
C’est à lui, et à tous les Winstons de notre « drôle » de monde contemporain et à leurs Muses, que je souhaite dédier ce livre.