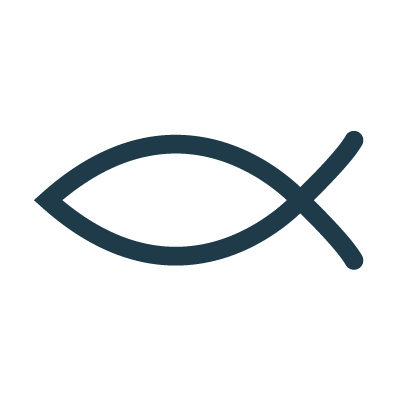En illustration de cet article : la famille Sackler (telle qu’incarnée dans la série Painkiller de Netflix), propriétaire du laboratoire pharmaceutique Purdue, responsable de la crise des opioïdes qui a fait à ce jour plus de 800.000 morts aux Etats-Unis. Aucune condamnation pénale, seule une amende a été infligée au laboratoire.
Ces transgressions de la loi commises par des individus issus des classes socio-économiques supérieures sont ici, par commodité, appelées « délinquance en col blanc » [white collar crime]. Ce concept n’entend pas être définitif, mais simplement attirer l’attention sur des crimes et délits qui ne sont habituellement pas perçus comme faisant partie du domaine de la criminologie. Un crime ou un délit en col blanc peut grosso modo être défini comme un crime ou un délit commis, au cours de ses activités courantes, par un individu bénéficiant d’une respectabilité et d’une position sociale élevée.
Edwin H. Sutherthland, White collar crime
1. Une urgence sociale
La recherche sur le sujet montre que la délinquance en col blanc n’est pas une simple affaire de quelques « pommes pourries », d’accidents individuels isolés à la périphérie du système, mais qu’elle constitue au contraire une composante structurelle de l’économie, opérant et prospérant dans une relative impunité au cœur même d’entreprises tout à fait légitimes et de tout premier plan.
Si cette délinquance peut être perpétrée sciemment et intentionnellement par des individus parfaitement cyniques et cupides – manifestement dépourvus de tout scrupule et prêts à tout pour s’enrichir le plus vite et le plus massivement possible – force est de constater qu’elle est aussi occasionnée de manière plus troublante par des auteurs qui n’ont pas réellement conscience d’être déviants, délinquants ou criminels, ou de causer quelque réel préjudice que ce soit – des auteurs allant même fréquemment jusqu’à se percevoir comme de bons capitalistes, des entrepreneurs habiles ou des fervents adeptes du libéralisme économique – tant nombre de pratiques dénuées d’éthique apparaissent à leurs yeux comme courantes, banales et triviales dans certaines cultures d’entreprise, voire dans certains pans entiers de l’économie.
Une composante d’autant plus systémique que la financiarisation, les dédales de la mondialisation, la dérégulation, la complexité croissante des organisations et des transactions ainsi que la dématérialisation de l’économie ont créé des opportunités inédites et massives d’expression et d’innovation de cette délinquance économique. Si la faillite retentissante et emblématique d’Enron en 2001 préfigure les multiples scandales financiers à venir, ce fut bien la crise financière de 2008 – essentiellement une crise de délinquance économique généralisée dans le secteur financier – qui a montré toute l’urgence qu’il y à lutter contre « la résistible ascension » d’une voyoucratie des affaires : une dérive criminogène qui tend à faire de ce début de XXIème siècle un inquiétant remake du gangster capitalism du XIXème siècle. Au travers d’une relecture criminologique tout à fait éclairante des dernières crises financières, et notamment de la crise des subprimes, Jean-François Gayraud a notamment mis en évidence le caractère profondément criminogène et les potentialités exceptionnelles de dérives criminelles d’un certain capitalisme contemporain dépourvu de boussole éthique, dont les protagonistes s’avèrent incapables de distinguer capitalisme légitime et prédation caractérisée.
Dans une telle perspective il est plus que jamais nécessaire, comme une urgence éthique, de lire et de redécouvrir White collar crime, l’œuvre maîtresse d’Edwin H. Sutherland (1883-1950) publiée en 1949, une œuvre qui constitue un changement de paradigme irréversible en matière de criminologie. Cet ouvrage a en effet bouleversé à tout jamais l’image que l’on peut se faire de la criminalité : tout particulièrement cette conception, encore trop répandue même aujourd’hui, selon laquelle délinquance et criminalité se trouveraient exclusivement concentrées dans les classes populaires dites aussi parfois, avec le plus profond mépris de classe, « dangereuses. » La postérité de cet ouvrage est d’autant plus considérable que c’est à lui que l’on doit la terminologie et la conceptualisation de « délinquance en col blanc » qui s’est imposée mondialement : les white collars (les élégants employés et dirigeants des bureaux) par opposition aux blue collars (les ouvriers en bleu de travail des usines).
C’est en effet depuis Sutherland que nous savons que les élites socio-économiques ont, à l’instar des classes populaires, également une certaine propension à des comportements délinquants et criminels : et que se faisant elles sont en position de causer avec une relative impunité des dégâts financiers et sociétaux bien supérieurs à ceux causés par la délinquance et la criminalité ordinaires. En somme : la criminalité est un phénomène sociologique normal et universel, associant à chaque classe sociale ses types de délits particuliers, un statut social élevé ouvrant simplement l’accès à des opportunités criminelles plus sophistiquées.
C’est aussi grâce à Sutherland que nous en savons beaucoup plus quant à la manière avec laquelle ces transgressions en col blanc sont commises ainsi que sur les dispositifs sociaux, à l’efficacité redoutable, qui permettent à ces transgressions commises par des personnes respectables, ou du moins respectées, d’éviter soigneusement l’opprobre et les stigmates sociaux d’un traitement pénal : un traitement pénal (police, justice, prison) qui reste quasi-exclusivement focalisé sur les transgressions de droit commun. Bien sûr des transgressions de ce genre ont pu être dénoncées avant Sutherland, notamment par les grands romanciers et moralistes du XIXème siècle, et au travers de quelques critiques sociales éparses formulées dans le monde académique. Mais Sutherland a transcendé cette indignation morale spontanée et diffuse pour en faire un sujet de recherche institutionnalisé à part entière, prélude possible à une éventuelle action sociale.
Ce « Nous savons » reste malgré tout une affirmation des plus optimistes : les constats tirés par Sutherland il y a plus de soixante-dix ans sont toujours l’objet d’un déni et d’une myopie aussi bien sociale que scientifique. Cette connaissance, si elle est instinctivement ressentie par de nombreux citoyens indignés à chaque nouveau scandale – le plus souvent vite étouffé, classé ou oublié dans le flot continuel d’informations et les complexités de procédures sans fin – reste encore aujourd’hui largement cantonnée dans les cercles très restreints des spécialistes de la question. Ces spécialistes de la délinquance et de la criminalité en col blanc forment une minuscule communauté, d’ailleurs pour l’essentiel présente dans le monde anglo-saxon avec de rarissimes, quoique talentueux, représentants en France.
Le sujet, en dépit de son actualité et de son importance capitale, ne semble pas générer d’enthousiasme délirant dans le monde universitaire ou dans les écoles de commerce, et les crédits comme les ressources humaines restent largement alloués aux délinquances de la rue et mafieuses plus conventionnelles. Les médias et l’ensemble des acteurs du débat politique n’ont quant à eux d’yeux, avec les mots à sensation les plus durs, que pour ce type de délinquance ordinaire. Mais l’on se garde bien de faire de la lutte contre la délinquance et la criminalité en col blanc une réelle priorité nationale, qui ne serait-ce qu’en matière de fraude fiscale appauvrit significativement les finances des nations au point de par exemple représenter actuellement l’équivalent du déficit public français. Les discours politiques convenus se focaliseront généralement sur la petite délinquance ou la fraude sociale, au coût comparatif pourtant dérisoire, plutôt que de cibler plus sérieusement les couteuses délinquances économiques des élites.
A la fraude fiscale relativement médiatisée, il convient de rajouter un ensemble de pratiques qui sont au cœur de l’activité économique sans pour autant être toujours visibles ou détectables : de fraudes comptables, des abus de bien social, des abus de confiance, des détournements de fonds, des actes de corruption, des manipulations boursières, des faillites frauduleuses, des publicités mensongères, des techniques de vente abusives, des entraves à la concurrence, des escroqueries petites ou grandes, des fraudes alimentaires et environnementales, des productions d’articles non conformes aux normes de sécurité, des rapports d’expertise falsifiés, des atteintes au code du travail et aux normes d’hygiène et de sécurité, des trafics divers et variés en temps de guerre, et de l’ensemble des comportement prédateurs déviants et abusifs exploitant les vides juridiques savamment constitués… qui affectent grandement et durablement les consommateurs, les contribuables, les créanciers, les actionnaires, les salariés, les retraités, les citoyens et des nations entières… avec souvent en bout de chaine des vies humaines ruinées, brisées, atteintes dans leur intégrité physiques ou morale, ou tout simplement annihilées. La délinquance et la criminalité d’affaires, contrairement à ce que l’on croit trop souvent, n’est pas qu’une affaire non-violente de détails purement techniques et administratifs sans réelle importance : elle a aussi un coût direct et indirect en vies humaines qui, bien que difficile à estimer, n’a rien à envier à celui causé par la délinquance ordinaire.
En cela le déni collectif, ainsi que l’absence de réaction sociale significative face à l’importance de cette insidieuse insécurité, restent toujours aussi présents aujourd’hui que dans l’Amérique du milieu du XXème siècle de Sutherland. Et quel symbole plus éloquent de ce déni et de cette omerta que l’absence, plus de soixante-dix ans après sa publication, d’une traduction française de White collar crime ? Alors que d’autres œuvres de Sutherland, certes importantes mais rétrospectivement moins marquantes que sa monographie sur la criminalité en col blanc, ont été traduites depuis longtemps en français, White collar crime, l’œuvre majeure qui a fait sa postérité, n’est mystérieusement toujours pas traduite en français.
Tout ce que le public francophone peut trouver en guise de traduction sont deux chapitres de l’ouvrage traduits séparément dans des publications académiques : Le problème de la criminalité en col blanc, traduit par Gilles Chantraine et Grégory Salle dans la revue Champ pénal ; La criminalité en col blanc est-elle une forme de criminalité ? aux Cahiers de la sécurité intérieure, traduit par Pierre Lascoumes. Bien que le choix de ces chapitres soit stratégiquement judicieux, et que la qualité de la traduction soit excellente, ils sont loin de couvrir tout le contenu du livre, non seulement sur le plan de l’analyse mais aussi en matière de théorisation. Leur caractère confidentiel, si caractéristique de ces publications universitaires, constitue un frein à une plus large diffusion de l’œuvre de Sutherland, si ce n’est dans le grand public (l’ouvrage de Sutherland reste un travail scientifique exigeant) du moins parmi une plus large communauté de chercheurs, d’étudiants, de praticiens et de citoyens tout simplement curieux de ces sujets fondamentaux et d’une urgente actualité.
Cet essai sur la délinquance et la criminalité en col blanc ambitionne avant tout de proposer à ses lecteurs une brève introduction à ce phénomène, et de constituer ainsi une modeste contribution pour une meilleure compréhension et une plus large prise de conscience collective de ce type d’insécurité.
Il se veut un plaidoyer pour que l’enseignement supérieur brise enfin les tabous et les non-dits sur le sujet, et que les futurs employés, cadres et dirigeants soient durant leurs scolarités sensibilisés à cette problématique majeure pour une meilleure prévention de ce grave fléau social
Il se veut aussi, enfin, un plaidoyer pour qu’une traduction française intégrale de White collar crime soit enfin produite par une maison d’éditions qui saura dignement faire honneur à ce classique des sciences sociales.
Le sociologue britannique Mannheim écrivit que si un Prix Nobel de criminologie avait existé, il serait sans aucune hésitation attribué à Sutherland pour son livre. Cette opinion demeure toujours aussi valide, tant il demeure la référence incontournable en matière de délinquance et de criminalité en col blanc : la vaste majorité de ses idées et de sa méthodologie restent aussi pertinentes aujourd’hui qu’elles l’étaient en 1949. Ses héritiers et successeurs dans la discipline ont nuancé, enrichi, développé ou critiqué les thèses de Sutherland, mais ne les ont jamais invalidées complètement, en prenant toujours cet ouvrage comme le point de départ obligé de toute réflexion sur ce phénomène.
Par-delà l’intérêt historique et scientifique qu’aurait une telle traduction, elle devrait avoir aussi le mérite d’aider à porter au-devant de la scène publique et politique cette problématique plus contemporaine que jamais. Et de sortir ainsi ce sujet des cercles confidentiels de spécialistes, pour une plus grande prise de conscience collective de ce type d’insécurité, le plus souvent objet de clichés réducteurs (« le tous pourris », « les pommes pourries ») cristallisés autour d’occasionnels « monstres » individuels et médiatiques.
Forcément on ne s’intéresse pas à ce type de sujet complètement par hasard et cet essai se poursuit donc par une présentation de la genèse et du contexte historique, intellectuel et biographique de White collar crime, qui s’efforcera d’éclairer l’intention de l’ouvrage (deuxième partie). Un tel plaidoyer n’aurait évidemment aucune chance de succès s’il ne montrait pas en quoi exactement ce livre est digne d’attention et de traduction. Ce plaidoyer aura donc pour pièce de résistance une présentation synthétique des principales idées contenues dans l’ouvrage de Sutherland (troisième partie). Cette présentation sera suivie par un complément d’enquête autour d’aspects sociologiques mais aussi psychologiques complémentaires aux idées développées par Sutherland (quatrième partie).
Quelques remarques en matière de terminologie avant de poursuivre…
Le terme anglais crime utilisé par Sutherland ne va pas sans poser quelques problèmes. Il contient un élément de gravité et de sanction pénale qu’on ne trouve pas forcément dans les transgressions des cols blancs, dont une proportion substantielle mériterait peut-être davantage le terme de déviance : c’est-à-dire une conformité à la lettre de la loi, mais une violation caractérisée de son esprit ou l’exploitation d’un vide juridique au travers d’actions « légales » dépourvues d’éthique et préjudiciables socialement. Néanmoins, comme Sutherland le montre bien, le white collar crime relève bien de la criminalité, ni plus ni moins que la délinquance et la criminalité de droit commun : cette parenté est notamment justifiée par les effets sociétaux particulièrement dramatiques produits par les cols blancs transgressifs, mais aussi par le fait que ces transgressions des élites n’évitent au fond la stigmatisation pénale que par un subterfuge social bien établi en amont. Parler de « criminalité en col blanc » peut donc sembler exagéré – on parlera plutôt d’un criminel s’agissant d’un meurtrier, ou de criminalité organisée et mafieuse – mais, après tout, uniquement car nous ne sommes pas habitués à l’entendre. C’est bien par naïveté, ou complaisance, qu’on l’imagine comme nécessairement non-violente, si l’on en juge par ses conséquences ultimes qui peuvent être considérables humainement.
L’essai se poursuivra cependant, comme son titre l’annonce, en faisant référence exclusivement à de la « délinquance en col blanc », et avec pour synonymes « délinquance économique » ou « délinquance d’affaires. » Le terme n’est certes pas parfait, mais c’est en dernière analyse probablement le moins mauvais. Une raison évidente est celle d’alléger le style au profit d’un terme médian dans la mesure où on pourrait en effet même énoncer pour être réellement exhaustif « déviance, délinquance et criminalité en col blanc. » Une autre raison est que le terme de « délinquance » semble peut-être plus pertinent pour rendre compte de l’ethos du col blanc transgressif moyen. Sutherland fait d’ailleurs dans son livre, nous le verrons, un parallèle entre délinquance en col blanc et délinquance juvénile. Il ne s’agit pas ici d’euphémiser quoi que ce soit – nous sommes bel et bien dans le registre du comportement criminel et un délinquant peut s’avérer extrêmement dangereux – mais il est vrai que la réalité des pratiques voyoucratiques observables dans le monde des affaires rappelle souvent la mentalité sous-jacente des actes de banale délinquance allant jusqu’à une jubilation tout à fait potache et récréative au cours de transgressions mêmes les graves.
Il semble toutefois nécessaire d’insister encore une fois que certains membres de cette voyoucratie des affaires méritent pourtant amplement le qualificatif de criminel à part entière – et ce pour des cas particulièrement sérieux commis en bande organisée, rationnellement, de sang-froid et à grande échelle, tels que par exemple : l’infraction continue et délibérée de réglementations en matière de sécurité et d’hygiène mettant en danger la vie de salariés ; la violation de normes sanitaires et environnementales avec des conséquences hautement toxiques pour la collectivité sur parfois plusieurs générations ; la production d’articles dangereux ne respectant pas les normes de sécurité ; des actes de prédation d’entreprises entrainant des licenciements massifs et des communautés sinistrées ; des hommes d’affaires peu scrupuleux qui détruisent les économies de toute une vie ou les retraites de nombreux citoyens honnêtes, qui ruinent des actionnaires, petits et grands, et parfois des économies entières dans le cadre de crises spéculatives et frauduleuses de grande ampleur comme celles de 1929 ou de 2008.
Avec ce type d’individus criminels particulièrement dangereux pour l’ordre public bien présents à l’esprit dans la suite de cet essai, le terme de délinquant demeure le moins mauvais, et ce pour une dernière raison fondamentale : le souci de distinguer la délinquance d’affaires, observable dans la sphère de l’activité économique légitime, de la criminalité organisée, notamment de type mafieux, qui n’est pas l’objet de cet essai. Ceci est conforme au terrain analysé bien spécifiquement par Sutherland, qui est l’activité économique d’entreprises qui ont pignon sur rue – et qui exclue aussi d’ailleurs, comme cet essai, la sphère politique. La corruption politique et la criminalité mafieuse font déjà suffisamment parler d’elles dans les médias et le monde de la recherche… il en va autrement de la délinquance de cadres et dirigeants opérant dans le monde de l’entreprise légitime, et c’est cette lacune que cet essai entend contribuer à combler.
On pourra objecter qu’il y a sans doute quelque chose de théorique à dissocier de manière aussi tranchée l’économie légitime d’une part, et l’économie mafieuse d’autre part, tant les passerelles sont évidemment nombreuses notamment en matière de blanchiment : des sommes colossales d’argent sale qui tôt ou tard finiront immanquablement, après de nombreuses manœuvres financières d’opacification, dans l’économie « normale. » Néanmoins cet essai restera délibérément focalisé sur le monde des affaires conventionnel, et dès lors le terme de « délinquance en col blanc » permettra peut-être d’éviter la confusion avec la criminalité organisée, et son réseau d’éminences grises qui le conseille efficacement… souvent bien difficile, il est vrai, de distinguer des hommes d’affaires « normaux » tant par le milieu social, les études, l’allure, les méthodes, et les aspirations.
2. Genèse d’un changement de paradigme
Une excellente introduction à la lecture du classique de Sutherland est fournie par Gilbert Geis et Colin Goff dans leur introduction à l’édition aujourd’hui de référence : White collar crime, the uncut version, publiée en 1983 par Yale University Press. Une traduction du livre de Sutherland ne saurait être complète sans également une traduction de cette introduction, qui de manière documentée et synthétique replace bien ce livre dans son contexte historique, scientifique et biographique.
Tout d’abord un moment clé dans la genèse de ce livre. Sutherland, figure éminente de la sociologie américaine de son temps, professeur et responsable du département de sociologie d’Indiana University et président de l’American Sociological Association, va délivrer à Philadelphie en 1939 un discours tout à fait historique lors de la réunion annuelle de cette association. Cette adresse fera même dès le lendemain les gros titres de la presse américaine, consciente de l’importance historique de l’évènement, un impact immédiat et fulgurant dont peu de communications scientifiques peuvent se vanter. Il y avait en effet de quoi.
Cette communication est disponible dans une version retranscrite publiée en 1940 sous la forme d’un article scientifique dans l’American Sociological Review avec l’intitulé sans ambiguïté White-collar criminality. Cet article contient déjà en gestation la plupart des idées maîtresses qui seront développées et étayées après dix ans de recherche dans son célèbre ouvrage. A commencer par la terminologie, white collar crime ou délinquance en col blanc, qui aura le succès considérable mondial que l’on sait. Mais surtout cet article remet fondamentalement en cause, pour la première fois et de manière irréversible dans l’histoire mondiale de la pensée sociologique et criminologique, le postulat communément admis alors (tant dans l’opinion publique que dans le monde scientifique) selon lequel délinquance et pauvreté seraient nécessairement liés.
Ce que Sutherland se propose de réaliser ainsi à partir de cet article – et qui est annonciateur de l’immense travail scientifique à venir culminant dans la publication de son livre – c’est un pont entre d’une part les économistes (qui ignorent tout des aspects criminels du monde des affaires) et les sociologues (qui ignorent tout du monde des affaires) pour intégrer les deux disciplines dans une théorisation de la délinquance en col blanc. Ce projet reste d’autant plus d’actualité que quatre-vingt ans plus tard cette convergence pluridisciplinaire, pourtant tout à fait cruciale pour une compréhension du phénomène, est très loin d’avoir eu lieu.
Cette délinquance économique est partout observable, nous dit-il, aussi bien dans les décisions de justice que dans les pages saumon des journaux, et elle n’a pas grand- chose à envier à celle des « barons voleurs » du XIXème qui sévissaient notamment dans les chemins de fer américains par l’expropriation violente des petits fermiers. Il fournit un catalogue de cette délinquance observable dans les cadastres, les chemins de fer, l’assurance, les munitions, la banque, les utilités, les bourses, l’industrie pétrolière, l’immobilier, les redressements et liquidations judiciaires, les faillites frauduleuses, et bien sûr la politique. A noter qu’à tort ou à raison il considère cette dernière bien moins corrompue en moyenne que le monde des affaires, point de vue qu’il reprendra dans son livre : « Diogène aurait eu le plus grand mal à trouver un honnête homme parmi les avocats d’affaires de Wall Street » ; « Aussi faibles soient- ils, les standards moraux demeurent bien supérieurs dans la sphère publique à ceux observables dans le monde des affaires, au point que les financiers qui s’engagent en politique se perçoivent comme des philanthropes. »
Les infractions commises citées par Sutherland incluent la fraude comptable, les manipulations de cours de bourse, la corruption de fonctionnaires pour obtenir des contrats publics ou une législation favorable, la publicité mensongère et des techniques de vente illégales, les détournements de fonds, les abus de bien social, les abus de confiance, les fraudes aux poids et mesures et en matière de qualité des produits, la fraude fiscale, et les détournements de fonds dans le cadre de faillites. En d’autres termes « Tout ce qu’Al Capone appelait « des rackets légitimes ». Ces infractions et beaucoup d’autres peuvent être identifiées en abondance dans le monde des affaires. » Il mentionne aussi d’autres professions connexes, a priori tout à fait respectables, telles que celles du monde médical comme étant aussi de fait largement criminogène : vente illégale d’alcool et de drogues, avortements clandestins, services illégaux rendus au monde de la criminalité organisée, faux rapports d’expertise et faux témoignages en cas d’accidents, cas extrêmes de traitements médicaux inutiles et dangereux, faux diplômes et partage illégal d’honoraires.
Sutherland convient que toutes ces observations ne permettent pas pour autant de mesurer précisément au plan quantitatif la délinquance en col blanc, mais elles invalident clairement ce cliché selon lequel la criminalité se concentrerait uniquement dans les classes défavorisées. Il précise qu’évidemment cela ne veut pas dire pour autant que tous les hommes d’affaires sont des délinquants ou des criminels, pas plus que les théories traditionnelles ne postulaient que toute personne issue des classes défavorisées est forcément délinquante ou criminelle.
Il souligne, point essentiel, que cette délinquance des élites socio-économiques n’est pas limitée à celle de vulgaires petits escrocs en périphérie du système, mais qu’elle se manifeste aussi et surtout de la part de grandes entreprises de tout premier plan. Ce qui est évidemment non seulement une avancée conceptuelle majeure… mais qui a aussi de quoi choquer tout le gratin de Corporate America dont il entreprendra d’établir en quelque sorte le casier judiciaire dans son ouvrage majeur à venir.
Et c’est bien là que se situera tout le problème de sa publication, dix ans de recherche et de maturation plus tard. Son livre sera bien finalement publié en 1949 par Dryden Press, la maison d’édition académique d’Indiana University où il enseigne… mais au prix d’une censure substantielle de certains éléments les plus dérangeants contenus dans le manuscrit. Sutherland va en effet mettre en évidence, décisions de justice à l’appui, le comportement proprement criminel de grandes entreprises américaines et en particulier des soixante-dix plus importantes sociétés industrielles, minières et commerciales de l’époque, dont certaines font toujours partie du paysage économique contemporain : American Can, American Tobacco, Chrysler, DuPont, Kodak, Firestone, Ford, General Electric, General Motors, Goodyear, Loew, Paramount, Procter & Gamble, US Steel, Westinghouse, pour citer quelques exemples.
Dryden et Indiana University craignent, probablement non sans raison, des poursuites en diffamation pour avoir estampillées ces sociétés comme « criminelles » (un qualificatif stigmatisant qu’elles arrivent normalement à éviter) mais aussi des représailles de la part de ces sociétés dans leurs financements de l’université. On va donc demander à Sutherland plusieurs choses : anonymiser les noms des entreprises citées dans l’étude, supprimer trois études de cas d’entreprises transgressives (dans la mesure où même anonymisées elles demeuraient identifiables) et enfin supprimer quelques passages jugés trop virulents et pamphlétaires et peu conformes à l’obligation de neutralité scientifique qui sied à un travail de recherche universitaire.
Sutherland va hésiter pendant près d’un an. Ses étudiants le soutiennent pour qu’il tienne bon, mais il va finalement céder, préférant que l’important message de fond puisse malgré tout passer afin de permettre d’initier tout un nouveau pan de recherches, au prix de concessions acceptables quant à la forme. On pourra se demander si Sutherland a manqué de courage intellectuel, ou si au contraire il a su mettre son égo de côté au nom d’une vérité scientifique supérieure à sa vanité d’auteur. On pourra également se demander si ces coupes étaient légitimes pour mieux défendre la dimension scientifique de l’œuvre, ou si au contraire une polémique de grande ampleur n’aurait pas eu le mérite de permettre de rompre des tabous et des dénis collectifs, toujours bien observables aujourd’hui. Pierre Lascoumes donne dans son excellent ouvrage au titre évocateur Elites Irrégulières une version romancée tout à fait passionnante de ce travail de censure universitaire et du dilemme moral qui a profondément agité Sutherland et ses proches collaborateurs.
Sutherland n’aura malheureusement pas le temps d’apprécier tout l’impact de son œuvre puisqu’il meurt des suites d’une attaque en 1950, laissant ses héritiers, admirateurs et critiques le soin de poursuivre la piste intellectuelle créée par cette œuvre monumentale. Il faudra attendre 1983 pour que cette œuvre soit finalement publiée uncut par Yale University Press, c’est-à-dire dans son intégralité et sans anonymisation des grandes entreprises étudiées.
Sutherland a cinquante-six ans lors de sa communication à l’American Sociological Association et il existe peu d’indices dans ses travaux précédents prédisant un intérêt pour la délinquance en col blanc. Tout ce qu’on peut dire c’est qu’il s’est montré un défenseur de la libre entreprise, tout en étant convaincu néanmoins que l’économie de marché se devait d’être régulée afin que la concurrence ne soit pas faussée et que les consommateurs ne soient pas par conséquence lésés.
On peut sans douter expliquer son intérêt pour le sujet et l’indignation morale qui fut la sienne, bien qu’il fût visiblement par ailleurs un scientifique tout ce qu’il y a de plus posé et mesuré, par son éducation. Son père était un pasteur baptiste à la foi plutôt stricte, et selon Geis et Goff on trouve chez le père comme le chez fils cette même exigence que l’éthique d’inspiration chrétienne soit maintenue dans le monde des affaires. Le ton pamphlétaire de Sutherland fils rappelle, toujours selon Geis et Goff, les prêches des prophètes les plus moralement indignés. Il y aurait donc une fondation théologique à cette idée majeure chez Sutherland selon laquelle le comportement acceptable ne saurait se limiter à la simple adhésion de façade à la lettre de la loi, surtout quand ces lois ont été en amont soigneusement établies pour permettre l’impunité de comportements socialement préjudiciables et des abus de pouvoir.
Les biographes font état du fait que Sutherland aurait pris ses distances par rapport à la religion et développé une fois adulte un certain goût pour le bridge, le golf et les cigarettes (des goûts trop libéraux que son strict père a sans doute réprouvé) mais qu’il serait resté malgré tout un homme d’une vertu et d’une intégrité viscérale en droite ligne de l’enseignement moral paternel. En complément de ces forts principes moraux qui lui furent inculqués, Sutherland a grandi dans une bourgade agraire du Nebraska, ce qui par contraste l’a aussi amené à être scandalisé par une ville corrompue comme Chicago où il étudiera et enseignera.
Toujours est-il que Sutherland va suivre la voie tracée par son père, qui était également un enseignant. Il enseignera tout d’abord le Grec et le Latin en début de carrière. Il découvrira la sociologie un peu par hasard en prenant un cours par correspondance, la sociologie étant un prérequis pour les études d’histoire qu’il envisage alors. C’est sans doute une révélation puisqu’il décidera finalement de conduire son PhD en sociologie à University of Chicago, avec une dissertation intitulée Unemployment and Public Employment Agencies (le chômage et les agences nationales pour l’emploi). Son professeur, Charles Henderson, un ex-pasteur baptiste justement et auprès de qui il suivra un cours de criminologie, aura une grande influence dans cette orientation vers la sociologie. Geis et Goff remarquent notamment que l’un des manuels écrits et utilisés par Henderson en cours contient déjà, trente ans avant les travaux de Sutherland, une certaine anticipation de ce qui allait apparaître chez l’élève :
Les classes sociales les plus cultivées fournissent peu de condamnés, mais des criminels bien éduqués. Ce haut niveau de culture modifie la forme du crime ; elle tend à le rendre moins grossier et moins violent, mais plus fourbe ; et à le restreindre à des formes quasi-légales. Mais l’éducation ouvre aussi la voie à des types de crimes nouveaux et colossaux, tels que la corruption du législateur, de la presse et de fonctionnaires. Les pulsions égoïstes sont masquées de cette manière, le malin se drapant du costume de la sainte charité pour dissimuler son caractère maléfique. Beaucoup de ces « Napoléons » du commerce portent bien leur nom, car ce sont des voleurs et des meurtriers de sang-froid, totalement indifférents à la misère qui, ils ne sont pas sans le savoir, sera causée par leurs machinations.
Il croisera aussi comme professeur le grand sociologue, et déjà pourfendeur de la société de consommation embryonnaire, Thorstein Veblen qui dans son œuvre maîtresse La Théorie de la Classe de Loisir dira notamment que le prototype du capitaine d’industrie est similaire à celui du délinquant « dans son utilisation des biens et des hommes à sa propre fin, sa plus complète indifférence aux sentiments et désirs d’autrui et pour les conséquences de ses actions. »
Entre 1913 et 1935 il va occuper plusieurs postes dans diverses universités pour finalement s’établir en 1935 à Indiana University où il mènera ses recherches sur la délinquance en col blanc et passer ses 15 dernières années. Initialement intéressé par les problématiques liées à l’emploi, il sera amené à se pencher sur la criminologie suite à une commande qui lui sera faîte de produire un manuel universitaire sur le sujet, publié en 1924 et qui deviendra un classique réédité à de plusieurs reprises de manière posthume : Criminology, traduit en français en 1966 sous le titre de Principes de criminologie. Il publiera également The professional thief, ou Le voleur professionnel, traduit en français en 1963. On le voit, ses travaux sur la criminalité ordinaire, largement oubliés depuis, ont été traduits en français, mais non son œuvre maîtresse sur la délinquance en col blanc – pourquoi ? – vers laquelle nous pouvons désormais nous tourner.
3. White collar crime
La thèse de ce livre, énoncée sans ambages, est que les individus issus des classes socio-économiques supérieures prennent part à bien des conduites criminelles ; que ces conduites criminelles diffèrent de celles des classes socio-économiques inférieures principalement de par les procédures administratives utilisées pour prendre des mesures à l’encontre de ces délinquants ; et que ces variations dans les procédures administratives sont sans rapport avec les causes du crime. Les causes de la tuberculose n’étaient pas différentes quand elles étaient traitées par des cataplasmes et par la saignée, et quand elles le furent par la streptomycine.
Edwin Sutherland, White collar crime
La contribution intellectuelle de Sutherland a été considérable puisqu’il a clairement mis en évidence l’existence d’une délinquance en col blanc opérant au sein des classes économiques supérieures, ainsi qu’au cœur même du système économique au sein d’entreprises de tout premier plan.
Il est ainsi allé courageusement à l’encontre à la fois des préjugés sociaux de son temps (et qui perdurent largement), mais aussi des travaux des sociologues et criminologues l’ayant précédé, qui ont complètement ignoré ces transgressions de la part des élites économiques pour ne traiter exclusivement que celles des classes populaires. Ce faisant Sutherland a remis en cause le postulat jusqu’alors bien établi selon lequel la criminalité serait nécessairement liée à la pauvreté, puisque précisément la délinquance en col blanc n’est manifestement ni causée par la pauvreté, ni par les pathologies sociales ou psychologiques généralement associées à la pauvreté.
Si cette délinquance économique est répandue, alors Sutherland suggère que cela pourrait permettre d’échafauder une théorie générale du comportement délinquant qui engloberait les délinquances des pauvres comme celles des riches. Or Sutherland fait précisément le constat que les délinquances en col blanc sont fréquentes, et qu’on retrouve de manière tout à fait courante dans le monde des affaires de son époque, en guère plus sophistiquées, les manières de voyous peu fréquentables des fameux « barons voleurs » du XIXème siècle.
C’est bien cette description et cette analyse des délinquances en col blanc qui lui sont contemporaines qui constituent le cœur de son ouvrage White collar crime. Sutherland va décortiquer 980 décisions de justice à l’encontre des soixante-dix plus importantes firmes industrielles, minières et commerciales des USA (il exclut donc on peut le regretter, et sans réellement l’expliquer, les banques, les assurances et les sociétés financières) soit un taux moyen de 14 décisions par entreprise. Ces décisions ont été répertoriées durant les vies entières de ces entreprises (soit une moyenne d’âge de 45 ans) et vont couvrir tout particulièrement les infractions suivantes : entraves à la liberté du commerce, publicité mensongère, atteintes à la propriété intellectuelle, atteintes au code du travail, commissions irrégulières, fraude financière et abus de confiance, et violations de règlementations applicables en temps de guerre. Seulement 16% de ces condamnations, soit 158, l’ont été devant des juridictions pénales. Sutherland prend soin de noter que ces décisions ne reflètent pas l’intégralité des infractions puisque beaucoup de cas sont résolus par règlements négocié privés en dehors de tout circuit judiciaire, et que de nombreuses décisions, purement administratives ne sont pas toujours publiées.
Il part du constat que les statistiques pénales font traditionnellement ressortir un taux de criminalité plus élevé dans les classes les plus populaires, du moins si on réduit la criminalité aux affaires de meurtres, d’agressions physiques, de cambriolages, de vols, d’infractions sexuelles, ou d’ébriété publique. Des études ont tenté d’étayer cette relation stricte entre criminalité et classes socio-économiques défavorisées, comme l’analyse des parcours personnels et la provenance géographique des délinquants qui révèle une forte influence de la pauvreté. A cette pauvreté s’ajouteraient, comme causes principales de la délinquance, des pathologies sociales et personnelles (potentiellement héréditaires croit-on alors) liées à cette condition de pauvreté : conditions de logement insalubres, absence de loisirs, manque d’instruction, perturbations dans la vie familiale, infériorité intellectuelle, instabilité émotionnelle.
Sutherland va dynamiter cette thèse. Il montre tout d’abord que certaines communautés, pourtant défavorisées, ont un taux de criminalité excessivement faible. Il montre également qu’on n’observe pas de corrélation entre délinquance et cycles économiques. Il explique surtout que les statistiques sont complètement biaisées : « le biais est aussi flagrant que si les universitaires avaient, dans le cadre d’une étude, sélectionné uniquement des délinquants roux, pour ensuite conclure que la rousseur des cheveux était la cause du crime. » dit avec humour Sutherland.
En effet, ce dernier rappelle justement que les personnes les plus aisées déploient une forte agilité en matière d’évitement des arrestations et des condamnations grâce à l’utilisation d’avocats expérimentés et en faisant jouer des relations haut placées. De plus les délinquants d’affaires « ne sont pas arrêtés par des policiers en uniforme, ni jugés au pénal, ni incarcérés ; leur comportement illégal reçoit l’attention de commissions administratives et de tribunaux civils ou de juridictions spéciales. » On saisit donc mieux la métaphore des roux délinquants : les statistiques criminelles sont biaisées sociologiquement puisque par construction les délinquances en col blanc, n’étant pas l’objet d’un traitement pénal et faisant l’objet d’un traitement social de faveur, ne sont tout simplement pas prises en compte dans les statistiques officielles.
Ce que Sutherland énonce dès le départ c’est que non seulement le coût financier de la délinquance en col blanc est largement supérieur à celui de la criminalité conventionnelle (qui est pourtant le centre de toutes les attentions) mais qu’elle engendre par ailleurs un coût moral colossal sur les relations sociales : des effets délétères qui corrodent en profondeur la confiance dans les institutions, ce qui produit de la désorganisation et de la démoralisation sociale à grande échelle.
La délinquance en col blanc est-elle un type de criminalité à part entière ?Autrement dit peut-on mettre sur le même plan les actes illégaux commis par des entreprises et leurs dirigeants et ceux de la délinquance et de la criminalité de droit commun ? Sutherland rappelle à ce titre que ce qui caractérise en principe un acte criminel c’est que cet acte soit à la fois dommageable pour la société et qu’il soit visé par une condamnation pénale. Le dommage social est manifeste, mais se pose en revanche la question du traitement judiciaire de la délinquance en col blanc. Celle-ci sera en fait l’objet d’un évitement de la sphère pénale – qui se concentrera sur la petite délinquance – au profit de procédures civiles et d’un traitement purement administratif et spécialisé, visant à occulter et effacer tout stigmate social et à éliminer finalement pratiquement tout trace du caractère criminel de la délinquance économique.
Sutherland fait à ce propos un parallèle entre la délinquance juvénile et celle en col blanc :
En matière de stigmate, la délinquance en col blanc s’apparente à la délinquance juvénile. Dans les deux cas, les procédures de la loi criminelle sont modifiées de telle sorte que le stigmate du crime ne s’attache pas au coupable. Le stigmate du crime a été moins bien détaché de la délinquance juvénile qu’il ne l’a été du crime en col blanc. Les dispositions qui règlent la première sont moins éloignées de la loi criminelle conventionnelle dans la mesure où nombre de délinquants juvéniles sont issus des classes inférieures et aussi parce que les jeunes ne se sont pas organisés pour protéger leur réputation. Parce que les délinquants juvéniles ne sont pas complètement protégés du stigmate du crime, ils focalisent l’intérêt des théoriciens du comportement criminel, au point de constituer la matière d’une bonne part de la criminologie. En ce qui concerne la délinquance en col blanc, les signes extérieurs du crime ont été si bien effacés qu’elle n’est généralement pas incluse dans le champ des études de criminologie. Pourtant, l’effacement de ces stigmates extérieurs ne suffit pas et il faut bien reconnaître que la délinquance en col blanc appartient logiquement au domaine de la criminologie, au même titre que la délinquance juvénile.
Sutherland explique ces différences de traitement juridique à l’avantage de la délinquance d’affaires par le statut de l’homme d’affaires, la tendance à l’adoucissement des peines et le caractère peu organisé de la réaction sociale à ce type d’insécurité. Les hommes de loi sont à la fois craintifs et admiratifs des hommes d’affaires. Il semble préférable de les laisser tranquilles tant leur influence sociale et leur capacité de représailles sont importantes. Mais au-delà de la crainte, Sutherland met en évidence tout le respect qu’ont les législateurs pour ces hommes d’affaires respectables qu’ils ne peuvent décidemment pas se résoudre à percevoir comme de vulgaires délinquants, ce qui leur accorde bien souvent dans la pratique une impunité et une immunité de fait. Ces hommes d’affaires ne se retrouveront en fait dans les tribunaux que s’ils commettent eux-mêmes des délits de droit commun dans leur vie privée. Cette relative absence de pénalisation de la délinquance d’affaires est la règle générale. La faiblesse et le caractère peu organisé de la réaction sociale à ce type d’insécurité s’explique selon Sutherland par plusieurs facteurs : des infractions plus difficiles à cerner et avec des conséquences plus diffuses qu’un acte de délinquance de rue classique, mais aussi un manque d’information de la part de médias, eux-mêmes détenus par des élites économiques qui se prêtent souvent aussi à ce type de transgressions.
Pour ces raisons l’opinion publique n’a pas à l’égard de la délinquance en col blanc une perception comparable à celle qu’elle peut avoir des transgressions de droit commun. Le rapport entre la loi et les mœurs tend finalement à être circulaire considère Sutherland. Les lois sont très largement une cristallisation des mœurs et chaque acte visant à respecter la loi tend à renforcer ces mœurs. En matière de délinquance en col blanc, les lois qui dissimulent le caractère criminel des comportements ont donc été moins efficaces dans ce travail de renforcement des mœurs.
Sutherland répond finalement par l’affirmative à la question posée : oui, les actes transgressifs commis par les entreprises ont toutes les caractéristiques du comportement criminel et relèvent bien de la criminalité au même titre que d’autres actes criminels ordinaires. La raison pour laquelle les criminologues n’ont pas jusqu’à ce jour considéré ces crimes comme étant sur le même plan que d’autres crimes tient en réalité, essentiellement, au fait que les délinquants en col blanc ont les ressources sociales pour éviter le traitement pénal via des procédures civiles et administratives qui ont l’avantage d’être invisibles socialement.
En étudiant le rapport qui existe en matière criminelle entre d’une part la responsabilité d’une entreprise dans son ensemble et d’autre part celle d’individus bien précis au sein de cette entreprise, Sutherland précise que la localisation de responsabilités individuelles est extrêmement difficile à établir et ceci conduit à son évacuation par des sanctions à l’égard des entreprises dans leur ensemble et non de dirigeants précis. De fait aussi un délinquant en col blanc opère généralement dans un réseau complexe de complicités plus ou moins actives, à l’intérieur comme à l’extérieur de son entreprise. Après avoir disséqué les infractions et les condamnations de ces soixante-dix grandes entreprises américaines, Sutherland développe ainsi l’idée majeure de sa thèse, à savoir que la délinquance en col blanc est de fait une forme de criminalité organisée.
Ces entreprises commettent des crimes et des délits à l’égard de consommateurs, de concurrents, d’actionnaires et autres investisseurs, d’employés, ainsi que de l’État sous la forme de fraude fiscale et de corruption de fonctionnaires. Ceux-ci ne constituent pas des violations isolées, commises comme par inadvertance, de simples réglementations techniques : ces violations sont tout à fait délibérées et forment un ensemble de pratiques cohérentes qui peuvent être l’objet d’une théorisation. Sutherland les compare avec la criminalité ordinaire, en isolant les similitudes et les divergences
En matière de similitudes, la délinquance des entreprises s’avère, comme celle de droit commun, l’objet de comportements multirécidivistes. Celle-ci est beaucoup plus fréquente que le nombre de condamnations l’indique, et beaucoup d’hommes d’affaires mis en cause banalisent totalement leurs infractions comme étant des pratiques monnaies courantes dans leur secteur d’activité. Les hommes d’affaires qui violent les lois qui régulent l’activité économique ne perdent pas généralement leur statut au sein des communautés économiques auxquelles ils appartiennent, bien au contraire. En ce sens ils ressentent et expriment ouvertement un profond mépris pour la loi, le gouvernement et les fonctionnaires, perçus uniformément comme des bureaucrates tatillons, coûteux et inutiles : tout comme le délinquant de droit commun, beaucoup d’hommes d’affaires ont tendance à voir les lois essentiellement comme des freins indésirables à leurs actions. Enfin, la délinquance économique, qui est tout à fait délibérée, est également une forme de criminalité organisée, de manière plus ou moins formelle comme on peut l’observer notamment dans toutes les pratiques d’ententes et d’entraves à la concurrence.
Quant aux différences, la plus importante que perçoit Sutherland est dans l’image que le délinquant en col blanc forme de lui-même et dont il bénéficie auprès de l’opinion publique. Le criminel de droit commun se perçoit bien comme un criminel et c’est ainsi qu’il est perçu par la société. En revanche le délinquant d’affaires se perçoit généralement comme un citoyen respectable et dans une large mesure c’est également ainsi qu’il est perçu par la société. « Même lorsqu’ils violent la loi, ils ne se perçoivent pas eux-mêmes comme des criminels. (…) Le délinquant en col blanc n’a pas pour image de lui-même celle d’un délinquant, parce que, du fait de son statut social, il ne fréquente pas intimement ceux qui se définissent eux-mêmes comme délinquants. » S’ils ne se perçoivent pas comme des délinquants ou des criminels, ils sont néanmoins bien conscients qu’ils violent la loi. Dans leurs échanges avec d’autres hommes d’affaires, au lieu d’en éprouver quelque honte, ils vont même jusqu’à se vanter avec grande fierté de ces violations astucieuses, et considèrent même que c’est en premier lieu l’existence de ces lois qui est surtout condamnable. Sutherland observe que c’est surtout parmi les jeunes hommes d’affaires, qui n’ont pas encore complètement assimilé les us et coutumes transgressives du monde des affaires, que ce sentiment de honte peut encore être observable.
De même, l’opinion publique ne perçoit pas du tout ces hommes d’affaires transgressifs comme des délinquants. Leur statut social est d’avantage relié à leur pouvoir exercé qu’à leur probité très relative. Par ailleurs afin de se distancier efficacement de toute stigmatisation possible, ils vont faire en sorte que la politique des grandes entreprises soit officiellement le respect vertueux des lois … et la transgression de ces dernières en coulisses. Cette opacité est facilitée par la complexité des processus en jeu dans le monde des affaires et les préjudices très diffus dans le temps et dans l’espace causés par la délinquance économique, par opposition au caractère évident et immédiatement observable de la criminalité ordinaire.
Les délinquants d’affaires développent un ensemble de rationalisations pour se cacher à eux-mêmes la réalité de leurs transgressions, avec des arguments du type « tout le monde fait pareil » et des euphémisations au travers d’un discours technico- managériale. Le secret, et en particulier l’anonymat, sont également entretenus par les délinquants en col blanc grâce aux paravents que constituent les entreprises en tant que personnes morales, et au besoin des sociétés-écrans. Les entreprises emploient également les services d’agences de relations publiques, de publicité, de conseil juridique et de lobbying. Leur fonction est d’influencer en amont l’établissement et l’application des lois, de conseiller leurs clients pour leur assurer des méthodes qui garantissent une relative impunité, ainsi que de les défendre devant les tribunaux et devant l’opinion publique si des poursuites sont engagées contre eux. Sutherland va même jusqu’à dire, sur un ton réellement pamphlétaire, en parlant de certaines entreprises : « Il est probable qu’aucun groupe humain à part les Nazis n’a jamais prêté autant d’attention à l’endoctrinement de la jeunesse de notre pays avec des idées aussi favorables à leurs intérêts et l’on peut même se demander si les Nazis n’étaient pas en fait plus attentifs à l’honnêteté de leur propagande. » Ce passage sera censuré en 1949.
La structure organisationnelle que représente l’entreprise a selon Sutherland deux avantages en matière de délinquance en col blanc : l’anonymat et la quasi-impossible assignation de responsabilités à des individus en particulier – c’est l’entreprise en tant que personne morale qui est généralement tenue comme responsable, mais rarement ses dirigeants – ainsi que la grande rationalité du comportement de l’entreprise. Cette dernière est sans doute la plus proche de l’idéal-type de l’homo economicus dans toute sa froideur calculatrice. La condamnation morale de Sutherland est sans appel, et il faut noter que le passage suivant sera également censuré dans la version de 1949 :
Le comportement rationnel, amoral et dépourvu de sentiments de l’entreprise était destiné à l’origine à l’efficience technicienne : puis par la suite elle a été destinée à la manipulation de l’opinion par la publicité, les méthodes de vente, la propagande, les lobbies. Avec ses récents développements l’entreprise est devenue réellement machiavélique dans son idéologie et sa politique. Elle a atteint la conclusion que pratiquement tout est possible si des ressources, de l’ingénuité et d’importants efforts sont consacrés. Elle s’est appropriée la physique et les sciences naturelles et les a appliquées à ses objectifs d’efficience technologique et a ce faisant fait d’importantes contributions à ces sciences. De manière similaire, elle s’est appropriée les sciences sociales et la psychologie et les a appliquées à l’objectif de manipulation de l’opinion.
Sutherland précise plusieurs aspects de cette rationalité en relation avec le comportement délinquant de l’entreprise. L’entreprise va sélectionner les infractions qui ont le plus petit risque de détection et contre lesquelles les victimes ont la moindre probabilité de se battre : « Les crimes et délits des entreprises sont similaires à ceux des voleurs professionnels : les deux sont soigneusement sélectionnés et les deux sont similaires au fait de voler des bonbons à un enfant en cela que la victime est toujours un faible adversaire. » Les victimes de la délinquance des entreprises sont rarement en position de se battre contre les dirigeants de ces entreprises délinquantes. Les consommateurs comme les petits actionnaires sont dispersés et ne sont pas structurés en organisations, et aucune victime ne souffre d’une perte suffisante pour justifier une action individuelle forcément coûteuse, longue et hasardeuse. De plus l’entreprise a la capacité d’opérer un lobbying efficace qui lui permet de faire pression à haut niveau pour que la législation ne soit pas appliquée ou, cas le plus fréquent, qu’un règlement du litige soit effectué discrètement en dehors de toute procédure judiciaire. Ceci est tout à fait similaire au remboursement par le voleur professionnel de la victime du vol pour mettre un terme à la procédure judiciaire à son encontre…
Sutherland conclue donc sur ce point en établissant que les infractions des entreprises sont délibérées et constituent bien une forme de criminalité organisée. Cela ne veut pas dire dit-il que les entreprises ne violent pas occasionnellement les lois par inadvertance, ou d’une manière désorganisée, cela signifie simplement que la vaste majorité des infractions est délibérée et organisée.
Sutherland ne se considère pas pour autant en position, sur la base des données dont il dispose, de formuler une théorie définitive de la délinquance économique. Les données disponibles permettent toutefois de penser que la délinquance en col blanc trouve son origine dans un même processus commun à toutes les délinquances, à savoir l’association différentielle. La théorie de l’association différentielle, dont il est à l’origine, est que le comportement criminel est acquis dans le cadre d’un processus d’apprentissage d’une compétence comme une autre, au contact de ceux qui perçoivent positivement l’activité criminelle et en isolation de ceux qui la perçoivent négativement : une personne va au final, selon cette théorie, développer un comportement criminel si et seulement si le nombre des jugements favorables à ce comportement est supérieur aux jugements qui lui défavorables dans son environnement. Ce processus d’apprentissage socialisé concerne non seulement les techniques mais aussi, point important, les processus mentaux de légitimation et de rationalisation de ces comportements.
Sutherland reconnaît que cette hypothèse n’offre peut-être pas un schéma explicatif complet ou universel de la délinquance, mais c’est à son avis l’une des meilleures pour interpréter les données disponibles sur l’ensemble des délinquances. Cette hypothèse ou toute autre hypothèse, précise bien Sutherland, ne sauraient être vérifiables que par l’étude directe des parcours professionnels précis de délinquants d’affaires, données qui ne lui sont malheureusement pas disponibles.
A défaut d’avoir accès à des éléments biographiques de la part de délinquants en col blanc de haut niveau (les biographies d’hommes d’affaires sont le plus souvent de la publicité personnelle hagiographique et l’on trouvera rarement dans ce type de littérature des aveux ou des analyses de pratiques transgressives) Sutherland va s’efforcer d’étayer son hypothèse de l’association différentielle en recueillant des témoignages de jeunes hommes d’affaires en début de carrière. Ces témoignages concordent sur le fait que ces jeunes hommes ont tenté dans un premier de travailler honnêtement, mais qu’ils ont dû renoncer à leurs principes devant la dure réalité sans scrupules du monde des affaires. Un de ces témoignages est particulièrement parlant. Il provient d’un jeune homme diplômé d’une école de commerce reconnue et qui travaille depuis plusieurs années dans une firme respectée d’expertise comptable :
Lorsque j’étais étudiant en école de commerce j’ai appris les principes de la comptabilité. Après avoir travaillé un certain temps dans un cabinet d’expertise comptable j’ai réalisé que je n’avais pas compris bien des choses importantes en matière de comptabilité. Un cabinet d’expertise comptable trouve son travail auprès d’entreprises et, dans une certaine mesure, doit produire les rapports que ces entreprises désirent voir produits. Le cabinet d’expertise comptable pour lequel je travaille est respecté et il n’y en a pas de meilleur dans la ville. Durant ma première mission j’ai découvert des irrégularités dans la comptabilité d’une entreprise qui amèneraient n’importe qui à s’interroger sur les pratiques financières de cette entreprise. Lorsque j’ai montré mon rapport à l’associé du cabinet, il m’a dit que cela ne faisait pas partie de ma mission et que je devais l’ignorer. Malgré le fait que j’étais tout à fait convaincu que cette entreprise était malhonnête, j’ai dû cacher cette information. C’est de manière répétée que j’ai été dans l’obligation de faire exactement la même chose dans d’autres missions. J’en viens à éprouver un tel dégoût pour ces pratiques que j’aimerais vraiment pouvoir quitter cette profession. Mais je suppose que je dois me faire une raison, puisque c’est la seule profession pour laquelle j’ai quelque expérience.
Ce type de témoignage provient bien, souligne Sutherland, de personnes provenant de familles et de quartiers « biens sous tous rapports » et n’ayant aucun antécédent en matière de délinquance juvénile : les délinquants économiques et les voleurs professionnels sont d’ailleurs rarement, nous dit-il, recrutés parmi les délinquants juvéniles. Dans le cadre de leur apprentissage sur le terrain de la pratique du business, un jeune homme bien éduqué avec d’excellents principes va petit à petit être initié et aspiré vers la délinquance en col blanc. Il va souvent recevoir des instructions de ses supérieurs de faire des choses qu’il considère comme illégales ou largement dépourvues d’éthique, mais il va aussi apprendre de ses collègues les ficelles irrégulières du métier. Il va qui plus est développer toute une idéologie bien spécifique qui est à la fois le produit de ses expériences et qui lui est transmis par son entourage, avec des expressions comme « les affaires sont les affaires », « on ne fait pas d’omelettes sans casser des œufs », « on ne fait pas du business avec des bons sentiments ». Ce type de généralisations va aider le néophyte en affaires à accepter de commettre des pratiques irrégulières et à élaborer des rationalisations pour être en paix avec sa conscience, et pour au final ne même plus percevoir d’irrégularités dans des pratiques devenues routinières.
Un autre argument qui milite en faveur de l’hypothèse selon laquelle l’association différentielle expliquerait la délinquance d’affaires est la diffusion des pratiques transgressives au sein d’une même industrie, notamment du fait des mécanismes de la concurrence. Une entreprise qui va découvrir un moyen de générer des bénéfices au- dessus de la moyenne du secteur par certaines pratiques illégales (par exemple le recours à de la publicité mensongère ou à des entraves à la concurrence) va naturellement essaimer ces pratiques dans tout son secteur économique. Plus généralement, un processus de sélection naturelle malsaine s’opère, qui permet à ceux capables de méthodes illégales d’éliminer du paysage des concurrents qui auraient un peu plus de scrupules.
Par ailleurs, toujours dans la perspective de l’hypothèse l’association différentielle, les hommes d’affaires sont non seulement en contact permanent dans leur milieu professionnel avec des jugements favorables à la délinquance en col blanc, ils sont également isolés de jugements qui désapprouveraient ce type de délinquance. Ils viennent assurément pour la plupart de familles respectables qui clament haut et fort les vertus de l’honnêteté. Mais ces bons enseignements au sein de la sphère domestique restent confinés dans ce petit monde isolé qui n’a aucune interaction avec le monde des affaires. Les individus qui perçoivent et dénoncent des pratiques d’affaires comme immorales ou illégales sont généralement taxées de moralisatrices, voire de « communistes » (attaques dont sera bien injustement l’objet Sutherland) et leurs voix dissonantes évacuées pour éviter des déplaisantes dissonances cognitives.
Qui plus est, les médias, toujours si prompts à des critiques virulentes à l’égard de la petite délinquance, se garderont de porter de pareils jugements sévères à l’égard des transgressions commises par les élites économiques : les raisons en sont tout simplement que ces médias sont eux-mêmes détenus par des hommes d’affaires puissants qui ont la même échelle de valeurs que les délinquants économiques ; qu’ils vivent de recettes publicitaires générées auprès de grandes entreprises, qui se verraient menacées en cas de critiques trop compromettantes ; et que ces médias ne sont pas eux-mêmes les derniers en matière de délinquance en col blanc (avec typiquement des entraves à la concurrence, de la publicité mensongère et des pratiques contraires au droit du travail).
Les hommes d’affaires délinquants sont également protégés de critiques qui pourraient provenir des gouvernants. Ceux-ci vont couramment passer des lois qui se gardent bien de jeter le moindre stigmate criminel sur les hommes d’affaires transgressifs, avec à la clé des procédures civiles et administratives light pour ces derniers, et des procédures pénales hard pour, par exemple, des syndicalistes qui enfreindraient la liberté du commerce. Cette attitude permissive et complaisante des gouvernants à l’égard des hommes d’affaires délinquants s’explique selon Sutherland par l’homogénéité sociologique et socio-culturelle des gouvernants avec les milieux d’affaires, des liens familiaux unissant gouvernants et hommes d’affaires, des relations personnelles d’amitié ou de copinage reliant les deux milieux, le caractère incestueux de la circulation des élites entre le gouvernement et le monde des affaires, et enfin le financement de campagnes politiques par les milieux d’affaires.
Outre l’hypothèse de l’association différentielle, qui reste le cœur de son analyse, Sutherland couvre brièvement l’hypothèse de la désorganisation sociale ainsi que celle de causes plus psychologiques, sans pour autant être très convaincu par ces deux approches. Il conçoit ainsi que la désorganisation sociale est de deux ordres : l’anomie, c’est-à-dire l’absence de standards moraux dans une société pour guider l’action des individus ; ou la présence dans une société de groupes différents ayant des standards différents et conflictuels. L’anomie provient notamment de l’érosion de valeurs morales traditionnelles dans le cadre de changements sociétaux et économiques majeurs et accélérés, qui n’ont pas encore permis l’établissement de nouveaux standards moraux (on pourrait sans doute de nos jours faire un similaire constat anomique). Le conflit en matière de standards est résumé de la manière suivante :
[L]’administration a peu de force pour stopper [les comportements transgressifs dans monde des affaires] à moins d’être soutenue par une opinion publique qui insiste sur une application stricte de la loi. Ceci requiert une opposition clairement définie entre d’un côté le gouvernement et les citoyens, et de l’autre les hommes d’affaires qui violent la loi. Cette opposition clairement définie n’existe pas, et ceci est la résultante d’un manque de réaction sociale organisée contre la délinquance en col blanc. Ce qui est, en théorie, une guerre perd beaucoup de son caractère conflictuel de par la fraternisation entre ces deux camps. La délinquance en col blanc perdure du fait de ce manque d’organisation de la part des citoyens.
Sutherland n’est pas pour autant complètement convaincu par le pouvoir explicatif de cette hypothèse de la désorganisation sociale, qui semble trouver alors un écho important en criminologie. Et il en va de même d’explications « psychologisantes » :
La tendance actuelle est de plaider l’instabilité émotionnelle comme la caractéristique psychologique qui expliquerait le comportement criminel ordinaire, et cette explication a été présentée tout particulièrement par des psychiatres et des psychanalystes. Mais même ceux qui professent cette théorie ne pourraient suggérer qu’en plaisantant le fait que les infractions de la Ford Motor Company sont dues au complexe d’Oedipe, celles de l’Aluminium Company of America à un complexe d’infériorité, celles d’US Steel à la frustration ou à l’agressivité, ou celles de Montgomery Ward à une régression infantile.
4. Complément d’enquête
Dans son analyse de l’économie des illégalismes, Foucault soutient que la bourgeoisie a imposé une catégorisation particulière pour la gestion de ses diverses transgressions en créant idéologiquement et juridiquement des qualifications et des procédures peu stigmatisantes qui la préservent de l’opprobre. Cette élite économique se donne ainsi la possibilité de « tourner ses propres règles et ses propres lois » et de réaliser une partie importante de la circulation économique « dans les marges de la législation » (provenant des lacunes des lois ou d’une ineffectivité entretenue). Quant aux poursuites engagées vis-à-vis de certaines pratiques, elles bénéficient de circuits spécialisés et échappent ainsi aux procédures judiciaires classiques.
Pierre Lascoumes et Carla Nagels, Sociologie des élites délinquantes
On vient de le voir, Sutherland n’est pas particulièrement adepte des explications psychologiques en matière de criminalité, et en cela on peut dire qu’il est bien représentatif de l’aversion coutumière des sociologues à l’égard de ce type d’explications. Et vice versa il en va d’ailleurs généralement de même de la part des psychologues à l’égard d’explications sociologiques de certains troubles, rendant les approches pluridisciplinaires psychosociologiques plutôt rares hélas. Malgré tout, on peut tout de même légitimement se demander s’il n’y aurait pas des troubles de la personnalité à l’œuvre derrière certains cas de délinquance et de criminalité à part entière en col blanc particulièrement graves.
Le criminel de droit commun ne se fait généralement guère d’illusions sur le fait qu’il est bien un criminel, il ne cherche pas à adopter une posture de respectabilité au sens pour ainsi dire bourgeois du terme : à défaut d’avoir des valeurs morales, on peut au moins lui reconnaître une certaine cohérence. Mais comment un délinquant d’affaires peut-il à la fois se prêter aux transgressions les plus graves et revendiquer en même temps auprès de son entourage – mais aussi à ses propres yeux, ce qui est encore plus troublant – un statut de respectabilité ? Doit-on parler de déni du réel ? De clivage ou de refoulement, pour emprunter une terminologie freudienne ? De personnalités voire d’organisations « borderline » ?
Gérard Ouimet, dans son très intéressant article Criminel en col blanc : un renard bien cravaté, comble une lacune dans l’analyse strictement sociologique en montrant précisément les troubles de la personnalité des délinquants en col blanc les plus extrêmes. Le portrait archétypal qu’il fait de ces individus est en synthèse celui de psychopathes narcissiques et machiavéliques. Le narcissisme est l’amour excessif de soi, un sentiment de supériorité qui entraîne la recherche constante de l’attention des autres. La psychopathie se traduit quant à elle par une impulsivité élevée, une insensibilité à l’égard d’autrui et une absence d’empathie, une recherche de sensations fortes, une absence de remords. Le machiavélisme enfin se caractérise par des affects froids, un manque de sincérité, une absence de préoccupations éthiques, une inclination à la fourberie ainsi qu’à la manipulation et à l’exploitation d’autrui.
Ouimet perçoit une relation particulièrement forte entre les transgressions graves en affaires et la personnalité narcissique (on pourrait même se poser la question d’une personnalité perverse-narcissique) : un sens grandiose de leur personne, le besoin excessif d’être admiré l’arrogance et la condescendance, un manque d’empathie, l’inclination à exploiter autrui, une très forte impulsivité, une affirmation débridée de soi, une maîtrise hors du commun de l’expression des pulsions pour permettre la manipulation mensongère des apparences… avec des réactions très agressives face à toute critique menaçante pour leur égo.
Quant au désordre mental particulièrement insidieux que constitue la psychopathie, le chercheur propose la définition suivante :
Forgé à partir des deux souches étymologiques grecques psyché (signifiant âme) et pathos (signifiant maladie), le mot psychopathie désigne un trouble permanent de la personnalité essentiellement caractérisé par un sévère manque de considération pour autrui découlant d’une absence de sentiment de culpabilité, de remords et d’empathie envers les autres. Affichant une apparente normalité en matière de moralité et d’expression émotionnelle, le psychopathe se révèle incapable d’éprouver au plus profond de lui-même des émotions sociales dont entre autres : l’amour, l’empathie, le sentiment de culpabilité, la contrition, la honte et la gêne. A l’instar d’un androïde programmé pour reproduire le plus fidèlement possible l’expression des sentiments humains, le psychopathe n’a d’humain que la forme. Sérieusement carencé sur le plan émotionnel, le psychopathe parvient, par mimétisme, à exprimer, verbalement ou physiquement, de tels sentiments sans toutefois les ressentir.
Ouimet propose un ensemble de caractéristiques symptomatiques de ces personnes particulièrement nuisibles qui sont tout à fait capables d’afficher une façade de santé mentale et de respectabilité, et de cacher leur trouble mental profond : la volubilité et le charme superficiel ; la conception grandiose de leur propre valeur ; le mensonge pathologique ; la tricherie et la manipulation ; l’absence de remords ou de sentiments de culpabilité ; la superficialité de l’affect ; l’insensibilité à autrui et le manque d’empathie ; la promiscuité sexuelle ; l’impulsivité ; l’incapacité d’assumer la responsabilité de ses actions ; la délinquance juvénile.
Le chercheur tire au final un portrait du délinquant et du criminel en col blanc haut en couleur…
Nous estimons que le criminel en col blanc de grande envergure serait en quelque sorte un homo vulpinus usant habilement et sciemment de la ruse afin d’abuser de la crédulité des gens ciblés pour être subtilement escroqués. A la fois charmant et baratineur, ce type de criminel serait l’une des incarnations de la psychopathie sympathique : l’exploitation des autres sous le couvert de l’apparence de la normalité sociale. Jouissant d’une respectabilité de surface générée entre autres par le statut social, le revenu économique, la fonction hiérarchique, la tenue vestimentaire impeccable, l’apparence physique soignée et la fluidité de l’expression tant verbale que corporelle, le criminel en col blanc opère illicitement au-dessus de tout soupçon. Dans le complet de ce maître de la tromperie, il y a fort à parier que se terre l’auteur de ce célèbre boniment : « Que vous êtes joli ! Que vous me semblez beau ! Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ce bois. »
Il est à fort craindre que ce type de personnalité narcissique-psychopathique-machiavélique ne soit particulièrement adapté au monde de l’entreprise, dans la mesure où dans ce dernier la règle fondamentale est de ne jamais se laisser attendrir par le facteur éthique dans la prise de décision. Dans ce monde des affaires la fin justifie généralement les moyens, l’éthique est systématiquement congédiée comme moralisatrice et hors-sujet dans un univers où, en dernière analyse, seul compte l’implacable calcul financier de la profitabilité organisationnelle et personnelle. On ne peut donc pas vraiment s’étonner que des psychopathes, et a fortiori des sociopathes, soient comme des requins dans l’eau du monde de l’entreprise, y compris en matière d’avancement de carrière où toutes les caractéristiques narcissiques et machiavéliques peuvent impunément et pleinement s’épanouir.
Mais faut-il atteindre de tels niveaux de dysfonctionnement moral pour être un délinquant en col blanc ? Après tout, en forçant un peu le trait de la caricature sociale, les premiers rangs des églises le dimanche ou des partis de l’ordre, à l’instar des films de Chabrol, comptent aussi des notables respectables, ou du moins respectés, qui en coulisses peuvent bien mener une double vie sentimentale… ou fiscale. Avoir une double vie ne fait pas nécessairement de quelqu’un un psychopathe, l’hypocrisie la plus banale suffit pour caractériser ces éternels Tartuffes. De plus ces délinquants en col blanc peuvent très bien s’avérer de bons pères de famille, qui pensent au confort et à la sécurité financière de leur petite famille, sans être nécessairement des monstres. Et s’il s’agissait au fond d’acteurs rationnels, des homo economicus faisant un arbitrage entre d’une part des avantages immédiats très forts liés à la transgression et d’autre part des risques très faibles de détection et de poursuites dans un contexte d’impunité organisée ?
Toujours est-il qu’il faut que les délinquants économiques, qu’ils soient des psychopathes et des sociopathes ou non, puissent tout de même continuer à se regarder le matin dans la glace de leurs confortables salles de bain avant de revêtir un respectable costume. Comment font-ils pour gérer ces contradictions ?
Les sociologues Pierre Lascoumes et Carla Nagels, dans ce qui est certainement le meilleur ouvrage sociologique de synthèse actuel sur le sujet (Sociologie des élites délinquantes, de la criminalité en col blanc à la corruption politique) font une analyse détaillée de ces processus essentiels de rationalisation des comportements transgressifs de la part des délinquants en col blanc, en poursuivant ce qu’annonçait déjà Sutherland sur le sujet.
Les auteurs d’actes transgressifs vont en effet entrer dans des processus de rationalisation et de neutralisation, « c’est-à-dire des techniques mobilisées par les acteurs pour neutraliser la charge émotionnelle liée à la transgression afin de conserver leur estime de soi », processus qu’ils vont apprendre au contact d’autres délinquants via le mécanisme d’apprentissage de l’association différentielle. « Dans leur conscience, la situation doit devenir sinon normale, du moins acceptable. Tenir à distance l’étiquette de « délinquant » leur permet de préserver une estime de soi. Les délinquants en col blanc élaborent des mécanismes de rationalisation efficaces et complexes en s’appuyant sur leur bagage socioculturel pour trouver des justifications à leurs actes. »
Les auteurs énumèrent un certain nombre de procédés de rationalisation et de neutralisation. Le déni de responsabilité : « ce n’est pas ma faute » (on profite alors de la dilution de la responsabilité dans une grande organisation), « j’ai fait ce qu’on m’a ordonné de faire, c’est le chef qui est responsable » ou « pourquoi moi et pas les autres ? » La banalisation de l’acte : « tout le monde fait pareil » ou « je ne suis pas un criminel, où sont les victimes ? ». Retourner la situation et mettre en cause ceux qui accusent, dans un discours de persécution et de délimitation de l’action des acteurs judiciaires : « ces lois sont à la base injustes et inadaptées », « les juges ne sont pas objectifs, ils poursuivent des intérêts particuliers, leur procédure n’est pas légale. » Invoquer des loyautés supérieures : « pour sauver des emplois » ou « pour le bien-être de la famille. » Au final les pratiques transgressives sont vécues comme normales, routinières, banales.
Lorsque les délinquants en col blanc sont malgré tout mis en cause, ils vont généralement résister avec succès à l’apposition de stigmates et à ce que Lascoumes et Nagels appellent des « rituels de dégradation » qui sont la base de la stigmatisation et créer ainsi la figure paradoxale d’un « coupable innocent. » « Lorsque les élites ne parviennent pas à nier leur implication dans la commission d’une infraction, la situation est alors présentée comme une exception aberrante ou un accident de parcours dépourvu de toute intentionnalité fautive. Le travail de la défense consiste aussi à saper la crédibilité, voire la moralité de ceux qui les accusent en montrant qu’ils sont partiaux ou règlent des comptes, qu’ils agissent par ressentiment ou égoïsme et non pour la défense de valeurs universelles. » Il s’agit tout d’abord de brouiller les pistes judiciaires et de discréditer la légitimité même des poursuites ou en recherchant des vices de procédure. Il s’agit aussi de minimiser les faits qui à la réflexion « ne sont pas graves » et qu’ils sont insignifiants par rapport à la « grandeur » supposée de l’homme en question. Enfin, l’on s’efforcera de diluer une responsabilité individuelle dans une organisation plus vaste en faisant référence à une erreur technique commise par inadvertance mais jamais à une faute morale personnelle.
Comme l’explicitait déjà Sutherland, nous sommes en présence d’une réaction sociale fortement différentielle : la délinquance en col blanc provoque une réaction sociale et judiciaire nettement moins importante que celle provoquée par la délinquance conventionnelle. L’ouvrage de Lacoumes et Nagels servira ici de guide pour préciser quelques idées complémentaires à celles de Sutherland.
Il est évident que ces processus de rationalisation et de neutralisation fonctionnement d’autant mieux que la réaction sociale, et notamment judiciaire, est faible pour ce type d’insécurité créé par les élites. A cet égard Sutherland anticipe avec ce qui sera l’une des thèses majeures de Michel Foucault dans Surveiller et Punir à savoir dans sa terminologie sociologique le traitement différentiel des illégalismes. Foucault met en évidence la manière différenciée avec laquelle la justice traite d’un côté pénalement (police, justice, prison) les délinquances et criminalités ordinaires des classes défavorisées, et d’un autre côté de manière nettement plus « policée » celles des classes supérieures via un traitement spécialisé administratif des plus discrets ayant pour principal objectif de les préserver de l’opprobre : transactions souvent en dehors de tout circuit judiciaire, réparations, régularisations, amendes atténuées, admonestations symboliques, dans le pire des condamnations avec sursis. La condamnation pénale étant très stigmatisante, les élites sont ainsi en mesure de soigneusement l’éviter.
L’impunité dont bénéficient les délinquants d’affaires est, de fait, structurellement organisée. En amont, par un lobbying efficace, les élites ont la capacité d’influer sur la production de lois… ou plutôt la non-production de ces dernières (en créant par exemple des zones grises et des vides juridiques qui permettent des interprétations « légales mais non éthiques ») notamment pénales, qui pourraient les menacer. L’insuffisance chronique des ressources policières et judiciaires en matière de lutte contre la délinquance économique complète cette neutralisation en amont. En aval, elles peuvent influer sur leur application en s’illustrant par une grande capacité à se soustraire aux règles édictées pour les autres, et par conséquent à éviter toute qualification infamante et réprobation sociale structurée. Cette impunité structurellement organisée est permise par une connivence entre les autorités de surveillance et les groupes qui sont censés être surveillés. Des liens personnels forts existent en effet entre les acteurs politiques, administratifs, policiers, judiciaires, et économiques : mêmes milieux socio-culturels, sentiment d’appartenance à une même classe sociale avec des solidarités naturelles et spontanées de classe, formations scolaires comparables, affinités psychologiques, caractère interchangeable de certaines fonctions (pantouflage par exemple), mêmes réseaux de sociabilité avec entraide et renvois d’ascenseurs (associations d’anciens élèves, clubs, franc- maçonnerie, organisations philanthropiques).
Les preuves et les responsabilités précises sont typiquement difficiles à établir, il n’y a que très rarement des victimes identifiables, aux préjudices clairement évalués et en position d’agir de manière collective de type class action. Les délinquants en col blanc excellent dans l’art du respect formel de la loi, mais non de son esprit, ou exploitent au maximum les vides juridiques qu’ils ont largement contribué à entretenir en amont. Les délinquants économiques sanctionnés sont surtout les petits fraudeurs ou des niveaux de management intermédiaires, parce qu’ils sont plus proches du lieu de l’infraction contrairement à d’éventuels donneurs d’ordre haut placés « au courant de rien. » et prudemment à l’abris de poursuites.
Les élites ont pour particularité de se considérer à la fois comme supérieures aux autres classes sociales et comme absolument nécessaires au bon fonctionnement de la société. Les détenteurs du pouvoir économique tendent ainsi à se percevoir au-dessus des lois et entretiennent un rapport élastique et négociable à ces lois qu’ils pensent s’appliquer essentiellement aux autres classes sociales. Au plan normatif, les élites entretiennent généralement un rapport distancié aux normes sociales, à la légalité, à la probité avec une perception relativement favorable de la cupidité et des actions orientées par le seul intérêt personnel indépendamment des conséquences pour autrui. Elles font souvent preuve de cynisme à l’égard des lois, et d’un total mépris à l’égard des modestes fonctionnaires en charge de les appliquer.
Le monde des affaires est au final un milieu criminogène comme un autre, néanmoins les élites bénéficient d’une forte capacité de résistance à la stigmatisation et d’un préjugé de non-dangerosité. Un vaste ensemble de pratiques délinquantes échappent à l’opprobre sociale. Une situation de déni socio-culturel collectif quant à la dangerosité des élites et la gravité de certains de leurs comportements qui est le produit d’un insidieux travail de domestication sociale, et qui explique largement pourquoi la lutte contre la délinquance économique n’est toujours pas prioritaire. Cette conduite collective de déni et de complaisance est socialement irresponsable puisqu’elle permet à des atteintes majeures à l’ordre public de perdurer avec la plus grande impunité.
L’insécurité causée par les élites transgressives est systématiquement euphémisée, minimisée, dédramatisée. On parlera d’« erreurs », d’ « accidents », d’ « incompétence », mais jamais de « fautes. » Contrairement à la délinquance ordinaire, la délinquance économique serait non-violente et n’occasionnerait, miraculeusement, pas de vraies victimes. Les responsabilités sont atténuées, une rhétorique déculpabilisante est à l’œuvre par des rationalisations alambiquées qui vont même jusqu’à légitimer idéologiquement les transgressions au point de ne même plus percevoir de transgressions du tout.
Chaque affaire révélée à l’opinion publique fait la une à sensation des grands médias, et suscite sur le moment un tollé général, une vague considérable d’indignation vertueuse dans l’opinion aux cris de « patron voyou » ou du « plus jamais ça ». Mais le flot continu d’informations, combiné au déni collectif sur ces sujets et la complexité technique des dossiers, font que l’attention retombe aussi vite qu’elle est montée, et que rapidement « on passe à autre chose », ceux qui continuent à commenter l’affaire étant encore taxés de harceleurs, d’obsédés ou d’enragés adeptes de prétendus tribunaux populaires. Cette amnésie collective sur ces sujets participe pleinement à l’invisibilité sociale des transgressions des élites et à maintenir l’absence de perception d’atteinte à l’ordre public par ces dernières.
La victimisation et la perception du dommage sont problématiques en matière de délinquance en col blanc. Contrairement aux atteintes physiques aux personnes et aux biens, il est habituel que la délinquance en col blanc, aux effets très diffus dans le temps et dans l’espace, ne crée pas un ensemble organisé de victimes ayant pleinement conscience de l’être et déterminées à obtenir réparation. Que ce soit des consommateurs, des salariés, des petits actionnaires ou de simples citoyens, peu subissent un préjudice personnel tel qu’ils vont s’estimer des victimes prêtes à affronter un processus judiciaire long et couteux, et beaucoup ne vont de fait même pas se rendre compte qu’ils ont été spoliés en premier lieu. Comme le résument bien Lascoumes et Nagels : « Si aucune victime ne se plaint de pratiques abusives, si personne ne les dénonce, si aucune autorité publique ne les relève, ces faits transgressifs demeurent invisibles, occultés par l’opacité sociale. »