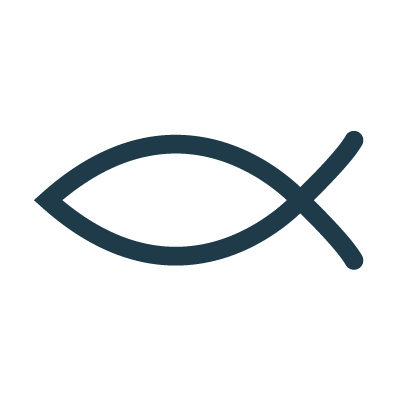J’ai écrit ce texte sur mon enfance au Plan d’Aou, une cité emblématique des quartiers nord de Marseille, en 2021 à l’approche de 50 ans et à peu près d’un jet. Je le publie ici sans le retoucher, pour mémoire, même si aujourd’hui je ne me reconnais plus complètement dans certaines affirmations : je me sens beaucoup plus enraciné dans ma région natale, je n’ai plus la même vision romantique de l’anarchisme, je suis mon intéressé par la critique sociale théorique et davantage par l’action politique concrète.
Je suis né un 17 août 1971 à 10h du matin à Marseille. Ceci fait techniquement de moi un lion ascendant balance. La légende familiale veut d’ailleurs que ma mère entendait dans sa chambre de la maternité rugir les lions du parc zoologique de Longchamp, qui n’existe plus.
Je ne suis pas sûr de croire en l’astrologie, mais j’aime cette idée qu’avec l’âge l’ascendant prend le dessus : en ce qui me concerne, le sens de la mesure prendrait le dessus sur l’hubris. Ceci fait de moi aussi un cochon dans l’astrologie chinoise, un être profondément chanceux. Je ne sais pas si je suis chanceux (j’ai parfois pensé être le plus chanceux des hommes… et parfois le plus malchanceux qui soit) ou si le concept même de chance a, rationnellement, quelque valeur : mais je note pour mémoire ici que j’ai le sentiment que le hasard a tenu un grand rôle dans mon parcours, au point même d’avoir consciemment cherché ces dernières années à le provoquer en misant sur ses possibilités créatives.
Être né à Marseille fait de moi enfin, théoriquement, un méridional : si j’ai une certaine tendresse pour cette ville (et son équipe de football) et la région autour qui m’est si familière, je ne me sens définitivement en rien méridional et n’éprouve aucun attachement particulier pour la Provence dans laquelle j’ai grandi et que j’habite de nouveau depuis quelques années pour des raisons essentiellement familiales. Et où je me sens toujours un peu un étranger, pour ne pas dire un touriste.
Quatre composantes de mon environnement familial ont exercé sur moi une profonde influence :
- Je suis issu d’une famille de révolutionnaires, des républicains espagnols exilés qui avaient voulu changer la société et le monde. Mes grands-pères s’étaient battus pour une révolution sociale et j’ai été bercé dans mon enfance par ces histoires d’une utopie concrète socialiste et anarchiste qui, avant d’être écrasée militairement, avait fonctionné. Longtemps loin de ces idéaux, de par ma formation et mon expérience professionnelle, je ressens une profonde filiation atavique dans ce désir qui est le mien aujourd’hui de contribuer à rendre le monde meilleur. L’utopie est-elle chez moi un moteur positif ou suis-je atteint de quichottisme, ça à vrai dire je me le demande et j’aurai certainement l’occasion d’y revenir…
- J’ai grandi et je vis toujours avec l’image d’une sainte mère qui s’est dédiée corps et âme aux service des autres, inconditionnellement et portant sa croix quotidiennement dans la joie et la bonne humeur, et en particulier mon frère lourdement polyhandicapé. Je suis profondément structuré par cette idée d’un don total de soi pour une cause, non pas théorique et idéologique, mais pour des autres bien précis. Pour son prochain, dirait-on en termes chrétiens. A ceci près que ma mère s’est toujours passée de l’hypothèse réconfortante de Dieu, et accessoirement des curés, ce qui ne la rend que plus sainte dans son dévouement laïc.
- J’ai aussi grandi avec l’image d’un père qui bien que très habile dans son métier de menuisier ne l’aimait pas particulièrement. Un métier qu’il n’avait pas vraiment choisi et qui fut le produit du hasard et de la nécessité de gagner sa vie très jeune n’ayant pas les moyens de faire des études, et qu’il avait conservé pour des raisons alimentaires en rêvant toute sa vie d’un autre destin professionnel. Il a toujours refusé de monter en grade et de « devenir chef ». Il a accueilli sa retraite comme une libération et je me souviens très bien de cette longue période de chômage qu’il avait manifestement beaucoup aimé en s’adonnant notamment à la peinture, d’un genre impressionniste : j’ai été profondément marqué par cette expérience et je crois que c’est là que s’origine ce qui a pu constituer chez moi un refus du travail, perçu comme une aliénation.
- J’ai enfin grandi en compagnie de mon grand-père paternel qui a vécu chez nous à la fin de sa vie (j’ai environ dix ans lorsqu’il meurt d’une crise cardiaque), figure bienveillante et lumineuse de mon enfance. Ayant fugué de son village aragonais pour tenter sa chance à Barcelone, un temps boxeur, puis torero, puis joueur (et arnaqueur) professionnel (aux cartes, qu’il truquait), puis révolutionnaire anarchiste, puis exilé et docker au port de Marseille, toujours élégant, amateur de Gauloises et ayant un faible pour les cartons tombés du camion (ce qui mettait mon père dans des colères pas possibles), copain de jeu extraordinaire, il incarnait pour moi et me communiqua je crois le goût pour l’aventure.
Ni par mes origines sociales, et ni encore moins par mes origines idéologiques, rien ne me prédestinait donc à réaliser les « brillantes » et largement improbables études supérieures commerciales qui furent les miennes à HEC, où l’on croise guère de fils d’ouvriers anarchistes bouffeurs de patrons : j’ai grandi à la grande époque d’Action Directe, et mon père disait par exemple souvent (sans le penser vraiment bien sûr) qu’il faudrait poser une bonne grosse bombe à la Bourse de Paris.
J’aurai l’occasion plus loin dans mon récit de revenir sur cette « brillance » communément admise au sujet de mes études. J’aurai aussi l’occasion d’émettre quelques griefs à l’égard de l’éducation que j’ai reçue, sans doute moins (je l’espère) dans la perspective de régler injustement et ingratement mes comptes avec mes parents que dans celle d’une auto-analyse où il est nécessaire de dire ce que l’on a dans le cœur, sans filtres, un peu comme sur le divan confidentiel d’un psychanalyste. Mais quoique je pense aujourd’hui au plan idéologique d’HEC et de l’univers qui gravite autour, je ne peux qu’exprimer ma plus profonde gratitude pour le remarquable travail éducatif « globalement positif » de ma famille sur moi : un travail plein d’intelligence et surtout d’amour. Si cet amour, comme tout amour, a pu parfois être maladroit, il a largement fait l’être que je suis aujourd’hui. J’ai eu de la chance d’avoir la famille que j’ai eu, et rien de ce que je pourrai écrire plus loin de vaguement critique ne saurait amoindrir cette pleine conscience que j’ai de cette chance.
Ceci étant dit, autre chose m’a fait dans mon parcours scolaire et social « atypique », un autre chose qui reste encore pour moi largement un mystère : c’est précisément ce mystère personnel que je vais tenter d’élucider dans ce qui suit.
Bande-son : le chant révolutionnaire anarchiste espagnol de 1936 « A las barricadas », qui fut chanté par le petit peuple ayant pris les armes pour faire échec au soulèvement militaire franquiste, et qui m’émeut et me transporte toujours à chaque écoute profondément.
2.
J’ai été conçu et j’ai grandi jusqu’à l’âge de douze ans dans une cité HLM des quartiers nord de Marseille, le Plan d’Aou. Bien que ces quartiers et cette cité en particulier soient généralement hautement stigmatisés, ne faisant typiquement la une que pour de sinistres histoires de règlements de comptes, j’en garde un très beau souvenir, un peu comme celui d’un paradis originel dont je fus chassé. Et va savoir pourquoi j’en tire même une certaine fierté à être passé par là. Ce fut, rétrospectivement, ma première expérience du cosmopolitisme, avec tout un tas de copains dont les parents venaient du monde entier m’exposant très tôt à une enrichissante diversité de cultures, de traditions, de langues. Mon seul ami « vraiment » français était d’origine corse, mon premier amour (tout à fait platonique) venait des Comores.
Les architectes qui avaient conçu la cité – je le vérifiai bien plus tard en faisant une recherche documentaire aux archives de Marseille qui confirma mon intuition – s’étaient inspirés des idées urbaines utopistes du Corbusier : le Plan d’Aou c’était un peu en somme la Cité Radieuse du pauvre. Mes parents avaient été ravis d’y être logés accédant ainsi pour la première fois à tout le confort moderne, et se sentaient à l’aise au milieu d’une population de braves gens, des prolétaires pour la plupart avec quelques familles de la petite classe moyenne.
Malgré ses bonnes intentions architecturales, l’utopie initiale tourna vite au désastre. Au bout d’une dizaine d’années d’existence la cité était devenue de plus en plus dure à vivre : dégradations permanentes, cambriolages (des pauvres volant d’autres pauvres, souvent leurs propres voisins), le spectacle quotidien de mobilettes et voitures volées et incendiées, les shoots dans les cages d’escalier (c’était à mon époque à la colle, l’héroïne viendra plus tard), les trafics divers et variés, les caïds et les gangs, les coups de feu occasionnels, les policiers ou les pompiers caillassés, l’abandon progressif des pouvoirs publics de la cité à elle-même.
Il n’y avait plus que les communistes pour s’y intéresser, qui s’illustraient notamment par des pétitions pour éviter l’expulsion de locataires indélicats (que mes parents ne signaient d’ailleurs pas). Je ne m’explique pas encore tout à fait d’ailleurs les raisons profondes de cet engrenage de la violence et de l’autodestruction. Bien que très modestes, mes parents eurent tout de même assez de moyens pour quitter la cité et se faire construire une maison (préfabriquée Phénix) dans une campagne péri-urbaine et pavillonnaire plus tranquille (et fort ennuyeuse pour un enfant).
Les immeubles de la cité furent, en plusieurs phases dans les années 90 / 2000, tous démolis. Il ne reste strictement plus rien du paysage urbain de mon enfance (les traces documentaires, notamment iconographiques, sont également très minces à ma connaissance, à moins qu’elles ne soient enfouies dans quelques archives obscurs et impénétrables), ce que, à tort ou à raison, je ne peux m’empêcher de vivre, avec mon âme de grand enfant, comme une autre forme de violence, institutionnelle celle-là.
Petit-fils et fils d’exilés, pur produit de la mondialisation, je ressens cette démolition de ma cité comme le symbole de mon absence radicale de racines, au sens où on l’entend généralement : racines qui restent peut-être encore aujourd’hui à construire ou du moins à réévaluer. Une métaphore aussi pour moi de la nécessité parfois, aussi douloureuse soit-elle, de tout détruire pour pouvoir recréer de la vie.
Mais en écrivant cela je me dis que, quand même, il y a bien au moins deux racines sur lesquelles je peux m’appuyer, qui ont un rapport avec une certaine Espagne et une certaine France.
Il serait vain et illusoire de partir en quête de racines dans la ville de mon père (Barcelone) et le village de ma mère (La Roda, dans la région de La Mancha, la patrie de Don Quichotte), je n’y serais encore une fois qu’un étranger, je ne me fais aucune illusion. J’ai bien sûr de la sympathie pour de multiples aspects de la culture espagnole, mais je ne me sentirai jamais Espagnol. Mon Espagne à moi, celle dans laquelle je souhaite et peux confortablement m’enraciner, c’est celle de la guerre civile, de sa révolution sociale et de l’anarchisme, qui ont une portée universelle, bien loin du folklore. Et qui sait, je note ça pour mémoire, peut-être qu’un jour je ferai mienne aussi, paradoxalement, l’Espagne des mystiques.
De même, aussi sympathiques soient-ils, je ne verrai jamais les Gaulois comme mes ancêtres (je les imagine plutôt maures et juifs) – ce n’est qu’un exemple parmi les divers marqueurs d’identité française auxquels les enfants d’immigrés sont censés adhérer pour « s’intégrer », sous peine d’être taxés de communautarisme, modèle volontariste dont on ne peut que constater sur le terrain les limites et l’échec – et de par le nom que je porte je me sentirai sans doute toujours probablement un peu un métèque en France : bien accueilli certes dans l’ensemble, mais comme on accueille un étranger, un invité qui se doit de bien se tenir.
En revanche, et j’en prends pleinement conscience en écrivant tout ceci, mon autre très grosse racine est la langue française, pas complètement mais presque indépendamment de la culture française. Mais c’est un français qui n’a pas la nature de l’évidence qu’aurait une langue maternelle, c’est un français synthétique que je me suis construit de bric et de broc et qui n’est pas dénué de considérations politiques et idéologiques : mon français n’est pas celui populaire, de la rue, avec un accent marseillais, auquel me prédestinait ma classe sociale d’origine ; mais ce n’est pas non plus, je crois, celui des diverses académies et autorités intellectuelles du pays qui font de cette langue un intimidant et sclérosé marqueur de classe, en l’occurrence bourgeoise.
J’ai le sentiment que mon français sans classe sociale me ressemble, dans un affranchissement (qui n’est peut-être que relatif) des déterminismes et des préjugés de classe, mais aussi du confort identitaire que procure l’appartenance à une classe sociale.
Je ne sais pas si ça a beaucoup d’importance dans la structuration de ma pensée, enfant, mais il se trouve que ma langue maternelle, au sens propre du terme, est en effet l’espagnol. Mes parents n’ont pas écouté les instituteurs qui recommandaient (pour ne pas dire ordonnaient) aux parents d’origine étrangère de parler français à leurs enfants à la maison, à la fois dans une logique résolument intégrationniste et parce qu’autrement, pensaient-ils sans doute de bonne foi, les enfants mélangeraient les deux langues (c’était vraiment une drôle d’idée). Le choix linguistique fort et je crois intellectuellement courageux de mes parents était basé sur le raisonnement suivant : plutôt que de lui apprendre un français de qualité médiocre à la maison, laissons-le acquérir un français de bonne qualité à l’école et donnons-lui l’opportunité d’apprendre une autre langue, l’espagnol, sans effort, et de s’enrichir de toute la culture qui va avec. Mais je crois qu’au-delà de cette rationalisation, il y aurait eu quelque chose de profondément incongru et contre-nature pour mes parents à me parler français, un peu comme si toi et moi nous nous mettions à communiquer dans un anglais ou un mandarin approximatifs.
C’est peut-être un fait universel que, malgré la bonne volonté des parents, toute éducation ne soit toujours qu’un échec plus ou moins grand, et j’aurai pas mal de choses à redire sur celle que j’ai reçue. Mais j’éprouve aujourd’hui la plus grande des reconnaissances à l’égard de mes parents pour ce choix du bilinguisme. C’était déjà un bel exemple à me donner d’insoumission à l’autorité des sachants de tous poils (et je soupçonne que mon père avait probablement raison de percevoir de la condescendance et du mépris de classe de la part de certains enseignants), une bonne leçon libertaire largement assimilée dès la plus tendre enfance qu’il convient de désobéir à l’autorité lorsque celle-ci rentre en conflit avec tes valeurs, ton esprit critique, ou simplement ton bon sens. Et évidemment il n’était pas nécessaire d’être un éminent linguiste à la Chomsky pour anticiper que mes parents faisaient le bon choix. Néanmoins, et même si j’ai pu vaguement lire que le bilinguisme aurait des vertus en matière de développement cognitif, je me demande tout de même si le fait d’être équipé de deux secondes langues (c’est comme ça que je vis mon espagnol, qui bien que plutôt bon, est loin d’avoir toute la richesse de celui d’un véritable locuteur natif) ne crée pas une certaine insécurité psychologique fondamentale dans le fait d’avoir le sentiment de devoir toujours un peu bricoler avec les mots. Mais c’est peut-être après tout le prix à payer pour expérimenter cette drôle de joie que procure le bricolage !
Bande-son : ça aurait pu être une chanson de Brassens, qui m’initia aux beautés subversives de la langue française, mais je choisis sans hésitation « Dans mon HLM » de Renaud dont j’appris par cœur les paroles enfant et qui m’initia sans doute à la sociologie… une drôle de sociologie d’ailleurs car le HLM de Renaud est remarquablement et étonnamment petit bourgeois !
3.
Par leur exemple quotidien de dévouement sacrificiel à l’égard de mon frère handicapé (qu’ils refusèrent de placer dans une institution, car cela aurait signifié selon eux l’abandonner), leur scrupuleuse honnêteté en toutes choses (mon père s’était largement construit en réaction au sien, trop aventureux à son goût, dans une moralité hautement revendiquée qui avait quelque chose d’un peu rigide), leur judéo-christianisme dans les actes débarrassé de l’hypothèse (réconfortante) de Dieu et de l’institution (réactionnaire) de l’Église, mes parents me font forcément penser à cette idée de « common decency » (ou décence ordinaire) que l’on trouve chez George Orwell. Je reprends ici un extrait d’un petit commentaire, que j’avais écrit il y a quelques années, d’un joli livre sur le sujet :
Le très subtil et plaisant essai De la décence ordinaire du philosophe Bruce Bégout permet de mieux cerner tout le sens et la portée de cette expression de « common decency » qui revient si régulièrement dans les textes de l’écrivain britannique George Orwell (1903-1950), notamment à partir de son enquête sur la condition ouvrière Le quai de Wigan de 1936.
Orwell perçoit un sens moral – inné́, instinctif, spontané́ – à l’œuvre dans la simple vie quotidienne des classes populaires : une inclination naturelle à faire le bien et une répugnance tout aussi naturelle à faire ou voir faire le mal. Ce qui suppose donc une capacité́ immanente et pré-juridique à discerner le bien du mal. Parmi les vertus qu’il observe chez les gens simples, on trouve selon lui : le sens du partage, la bienveillance, la solidarité́, l’entraide, l’humilité́, la chaleur, l’humanité́, la politesse la plus élémentaire, un sens profond de l’honnêteté́ et de la justice ainsi qu’une capacité́ d’indignation viscérale face au mensonge et à l’injustice et un dégout pour tous les abus de pouvoir et la domination.
Le terme anglais de common decency, aujourd’hui mais déjà̀ à l’époque d’Orwell, a quelque chose de désuet, de « vieille Angleterre », équivalent peut-être des « bonnes mœurs et bonnes manières » en français. « Pour ce qui est des conceptions morales il n’y a rien de plus bourgeois que la classe ouvrière » dit justement Orwell. Pour autant il s’agit surtout d’être respectueux de l’autre et « des choses qui ne se font pas », que de s’évertuer à apparaître « respectable et respecté » dans une quête sans fin de statut social. En ce sens Bégout oppose à la décence ordinaire des gens simples l’ « indécence extraordinaire » de certaines personnes parmi les plus fortunées : indécence (et obscénité́) d’un trop plein de richesse ostentatoire, de pouvoir, de volonté́ de puissance, de violence, de ricanements cyniques. Ayant demandé à un ami britannique d’illustrer la common decency il me suggéra Donald Trump comme son plus parfait contraire : à méditer.
Il est important de signaler que cette décence ordinaire qu’Orwell voit à l’œuvre dans le peuple, ne signifie pas pour autant une quelconque supériorité́ morale ou sainteté́ intrinsèque du pauvre par rapport au riche. Cette inclination naturelle au bien et cette répugnance tout aussi naturelle au mal existe dans absolument chaque être humain, elles sont simplement perdues ou corrompues par une surabondance de richesses matérielles. En d’autres termes, la vie quotidienne la plus humble et ordinaire – quel que soit par ailleurs le niveau de fortune – possède en elle-même des propriétés vertueuses qui permettent d’actualiser les dispositions morales de chacun. « Le monde ordinaire où l’herbe est verte, la pierre dure », celui du goût des choses les plus simples comme l’atmosphère amicale d’un pub ou la pratique du jardinage, son bons sens résolument terre à terre, ont une dignité́ et une grâce en soi qui ne sont pas nécessairement les signes scandaleux de l’inégalité́ sociale : une vie simple et humble incite tout simplement à la vertu, alors qu’une vie démesurément opulente et comme on dit aujourd’hui bling bling inhibe son développement.
« S’il y a un espoir, il réside chez les prolétaires » écrit dans son journal clandestin Winston Smith, le héros du dystopique 1984, seul (et peut-être dernier) être lucide dans un monde totalitaire où tout est mensonge. Pourtant George Orwell n’idéalise pas non plus la classe ouvrière et dans la description qu’il fait dans ce même 1984 de ces prolétaires, on retrouve aussi ce qui, bel et bien tristement, accable souvent les classes populaires : des raisonnements à très courte vue et un horizon intellectuel pauvre et limité avec l’obsession de subvenir difficilement aux besoins les plus primaires , un abrutissement par un travail pénible, monotone et répétitif et des loisirs consacrés à d’appauvrissants divertissements produits de manière industrielle, avec pour toute vague espèce de révolte contre le système de pathétiques actes de délinquance dépourvus de toute ambition politique.
C’est vrai mes parents aimaient les plaisirs simples de la décence ordinaire orwellienne : chez ma mère, cuisiner pour faire plaisir, la couture et le tricot, les fleurs ; chez mon père, le jardinage (une fois que nous eûmes quitté le HLM) et, dans sa jeunesse, la pêche à la truite. Mais jamais je ne vis ce dernier fréquenter l’équivalent français du pub : pour lui les cafés évoquaient l’assommoir au pastis et au tiercé, l’horreur absolue à ses yeux pour un ouvrier. Très grande différence surtout avec l’ouvrier britannique qu’appréciait Orwell, mon père possédait un niveau de culture générale assez remarquable pour sa condition sociale : on écoutait ainsi à la maison du jazz et de la musique classique, il s’intéressait beaucoup à la peinture, nous allions souvent au musée voir des expositions, mes cadeaux avaient le plus souvent une valeur culturelle, la bibliothèque était plutôt bien fournie en classiques et dictionnaires, la plus belle pièce étant l’encyclopédie Larousse en 20 volumes qui m’impressionnait beaucoup. Cela s’expliquait largement par l’école anarchiste qu’il fréquenta le temps de la guerre civile, le mouvement anarchiste d’alors accordant une grande importance à la culture comme moyen d’émancipation intellectuelle de la classe ouvrière. Ce n’était peut-être pas aussi riche culturellement que dans un foyer bourgeois (encore que), mais j’ai clairement grandi sur un terreau assez fertile intellectuellement.
Pourtant, je ne le réalise que maintenant, quelque chose clochait profondément dans l’éducation que j’ai reçu, malgré d’indéniables bonnes choses. Et c’est qu’au fond ils m’ont éduqué avec essentiellement pour obsession mon ascension sociale via l’ascenseur scolaire. Bien sûr difficile de leur jeter la pierre, cela partait de bonnes intentions « pour mon bien ». Bien conscients de la pénibilité et de la précarité de la condition ouvrière, on peut comprendre qu’ils aient voulu que je m’en affranchisse pour accéder à un niveau de vie plus confortable que le leur. Néanmoins où était la cohérence entre d’une part les idéaux de gauche largement anticapitalistes avec lesquels ils m’abreuvaient, et d’autre part cette aspiration à faire de moi, finalement, un petit bourgeois bien installé ?
Pourquoi ne m’ont-ils pas plutôt éduqué dans la perspective de faire un jour un métier noble et utile à la société (c’était assurément le cadet de leurs soucis), qui évidemment me plaise et m’attire, dans lequel je puisse me réaliser intellectuellement et moralement en cohérence avec les belles valeurs profondes qu’ils m’avaient inculqué et qui accessoirement, mais accessoirement seulement et non pas comme finalité en soi, m’aurait nourri décemment ?
J’entends encore mon père me rabâcher « Si tu n’as pas de bonnes notes à l’école, t’iras laver les chiottes chez Renault » : c’était à l’évidence très limité et particulièrement limitant comme message, et c’est là que je mesure à quel point malgré ses discours et sa culture mon père demeurait profondément aliéné dans sa condition ouvrière (ce en quoi il était une victime et ne peux lui en vouloir), où l’expérience de la nécessité matérielle ou (peut-être encore pire) la peur permanente de la subir à l’avenir détruit et corrompt profondément l’âme d’un homme. Le sommet de la pyramide de Maslow n’est pas moins essentielle, à la longue, que la base.
C’est pour cela que je reçois désormais – ce fut un long cheminement d’en arriver là – avec le plus grand scepticisme la promotion de l’école et de la fameuse « réussite scolaire » comme « ascenseur social » : à mes yeux ça n’a définitivement strictement aucun intérêt en soi de changer de classe « vers le haut » (« haut » censé être universellement désirable, et c’est là où les classes dominantes exercent aussi une domination sur les esprits et cherchent en permanence à se rassurer sur la légitimité de leur position), ce qui compte en revanche me semble-t-il c’est l’émancipation, ce qui est radicalement différent et, puisqu’autrement plus dangereux pour l’ordre social établi, nettement moins promu. Tant que les pauvres aspireront plus ou moins consciemment à être des bourgeois, et notamment par procuration en projetant leur désir sur leur progéniture, il y a peu de chances en effet que la structure fondamentalement oppressive de la société évolue.
Mon père m’avait offert une petite série de livres intitulée « Encyclopédie de la jeunesse », dont l’un des volumes était « Que ferai-je plus tard ? », avec le sous-titre « 500 métiers des plus traditionnels aux plus nouveaux » et en couverture la photo d’un astronaute. Je ne crois pas que ce livre m’ait profondément marqué, une profession cela devait me sembler bien abstrait et lointain. Je me souviens d’avoir eu à un moment dans la petite enfance le désir d’être marin, peut-être inspiré par nos promenades le dimanche au port autonome de Marseille et déjà une envie de voyages lointains : humble choix, et humilité d’autant plus grande que je doutais en moi-même de pouvoir le devenir un jour, ayant à l’époque horriblement peur de l’eau et ne sachant pas nager (ce qui devait me sembler problématique pour un marin).
Mais en le reprenant aujourd’hui je regrette de ne pas l’avoir lu avec plus d’attention et que mon père ne s’y soit pas intéressé, avec moi. Ensemble, « collaborativement » (mais ce n’était pas le style de la maison), nous aurions pu choisir une belle profession vers laquelle tendre. Il y a peu de chances que nous aurions choisi la profession de banquier (que je devais pourtant exercer bien plus tard, j’y reviendrai bien sûr) : comment aurait-elle pu nous faire rêver tous les deux ? Nous aurions pu en revanche choisir la profession d’architecte – dans une autre vie c’est peut-être ce que j’aurais aimé être – ce qui pour lui, ouvrier du bâtiment, aurait pu être une belle perspective et qui pour moi aurait permis de réaliser l’ensemble des aptitudes et affinités intellectuelles généralistes que j’allais rapidement démontrer. Mais peut-être, je me console, me fais-je encore une image trop romantique de cette profession, des Corbusier il n’y en a pas beaucoup, et j’aurais peut-être fini par travailler sur des constructions bassement utilitaires et sans âme comme laquais de cupides promoteurs ! Toute éducation n’est-elle donc pas bien vouée, comme je le disais précédemment, à être un échec ?
Ce qui est sûr en tout cas c’est que m’orienter vers une belle profession qui me fasse un peu (beaucoup) rêver, quitte à ce que le projet change en cours de route, aurait pu donner du sens et vectoriser mon énergie dans le travail scolaire, qui fut longtemps réduit à la poursuite court-termiste, mécanique et conformiste de « bonnes notes » sans réel horizon autre que la perspective de déchoir un jour si je ne les obtenais pas.
Bande-son : ça aurait pu être la délicate et espiègle Symphonie des Jouets de Mozart, qui fit mon éveil à la musique classique, mais j’ai choisi plutôt le conte musical Pierre et le Loup de Prokofiev conté par Gérard Philippe et interprété par l’orchestre symphonique d’État d’URSS en 1956. Créé en 1936 au moment des purges staliniennes par un compositeur officiel du régime, j’y vois rétrospectivement comme un clin d’œil à un profond intérêt que j’aurai bien plus tard pour le communisme…
4.
« Ce n’est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c’est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience » écrit Marx quelque part. Ce point de vue déterministe est dans l’ensemble je crois, selon mes observations, largement valide mais on sait aussi, même en sociologie, qu’il existe une marge d’indétermination, et peut-être donc de liberté individuelle, dans toute trajectoire humaine. J’aimerais donc dans cette évocation de mon enfance être désormais moins sociologique et plus psychologique pour m’efforcer de mieux comprendre mon individualité dans sa possible singularité.
C’est toujours très difficile pour moi d’en parler, car je ne souhaite pas faire preuve d’arrogance, mais le fait est que dès l’école maternelle j’ai manifesté des aptitudes intellectuelles très au-dessus de la moyenne. Ce n’est pourtant que très récemment que j’ai pris pleinement conscience d’avoir été ce que l’on appelle généralement (avec des termes qui ne me satisfont pas) un enfant « surdoué », « précoce » ou « à haut potentiel ». Je préfère peut-être, même si je n’ai à vrai dire aucune idée de sa valeur scientifique, le terme de « cerveau droit », qui suggère davantage un « cablage » différent des « cerveaux gauches », censés être largement majoritaires, et moins une quelconque supériorité intrinsèque. Un cablage qui, sous certaines conditions, permet au cerveau d’être une véritable Formule 1 – avec des facultés d’apprentissage exceptionnelles, déconcertantes de facilité, sans effort – mais qui, sous d’autres conditions, fait du cerveau la plus poussive des mobilettes.
Je ne sais pas si des dispositifs existent de nos jours pour scolariser de façon adaptée – est-ce même désirable ? – ce type d’enfants – avec un diagnostic qui est loin d’être évident à établir – mais je soupçonne que les choses n’ont pas vraiment changé par rapport à l’école que j’ai connu. Pour reprendre la métaphore automobile, je vois fondamentalement l’école – par ses contenus, ses méthodes, son rythme – comme une auto-école où l’on apprend à conduire son cerveau sur des modèles de masse tout à fait standards. Et d’ailleurs on sait que, paradoxalement, beaucoup d’enfants censés être surdoués, ont le plus grand mal à passer leur permis dans ces conditions et se retrouvent en échec scolaire.
Mais tel ne fut pas mon cas, et en un sens l’institution scolaire s’est efforcée de s’adapter à moi dans la mesure de ses structures. Après un brillant CP et quinze jours en CE1 (où j’ai le souvenir d’avoir été un épouvantable bavard perturbant la classe) il fut décidé de me faire sauter cette classe pour me faire passer directement en CE2. Je ne garde aucun souvenir de fierté particulière à l’époque, plutôt un vague sentiment d’être « anormal » dans une classe où tout le monde me semblait bien plus vieux que moi. Sentiment d’anormalité renforcé par ces énormes lunettes (c’est du moins comme cela que je les vivais) que l’on me fit porter à peu près à ce moment et un (léger, mais qui me semblait énorme) surpoids (je me souviens d’avoir fait mon premier régime vers dix ans, imitant celui de mon père).
Je crois que j’ai dès la plus tendre enfance montré un désintérêt profond et une résistance viscérale à l’égard de ce que je synthétiserais comme « l’appréciation purement quantitative de la performance dans des logiques de compétition », qui est somme toute le modèle idéologique dominant de notre époque et auquel au fond l’école ne fait que formater. L’idée de devoir travailler dur pour obtenir des bonnes notes et être le premier de la classe était pour moi une pure abstraction résolument contraire à ma nature, à laquelle il n’y avait pas moyen de me plier. J’ai alterné les « encouragements, les « peut mieux faire » et les « félicitations » sans faire réellement d’efforts, absorbant comme une éponge lorsque le sujet m’intéressait positivement de manière désintéressée, trainant les pieds lorsque le sujet (ou le professeur) me semblait dénué d’intérêt.
Je crois que j’aurais été un bon candidat pour des méthodes d’enseignement innovantes (je pense peut-être à Montessori) axées sur le plaisir et le jeu, car ma soif d’apprendre était véritablement instinctive et je n’avais vraiment pas besoin d’être « poussé au c** » : le système des notes (perçu généralement comme « structurant » et parfois comme un mal nécessaire) a été rétrospectivement pour moi essentiellement un perturbateur dans mon développement intellectuel, en m’incitant à bachoter bêtement et en corrompant mon amour tout à fait innocent et spontané pour les joies de l’esprit. Au-delà de mon cas personnel je suis d’ailleurs convaincu que nous en sommes encore à l’âge de pierre en matière d’éducation et que la « productivité » réelle du système scolaire actuel est à peu près nulle, ou du moins bien inférieure à ce qu’elle pourrait être si on adoptait des principes pédagogiques mobilisant plus intelligemment les aptitudes cognitives naturelles de tous les enfants. Mais bien sûr si la fonction de l’école est de permettre la reproduction de la stratification sociale – avec juste ce qu’il faut de régénération des élites pour que la société ne s’atrophie pas complètement – et de fournir de la main d’œuvre adaptée (et docile) au système capitaliste existant on jugera sa productivité actuelle tout à fait satisfaisante…
En dépit de ses limites et de ses défauts, je crois que j’ai profondément aimé l’école. Elle me nourrissait intellectuellement, mais c’était surtout pour moi un fantastique terrain de socialisation : une véritable cour de récréation permanente, et d’ailleurs j’étais assez malheureux pendant les vacances et attendais toujours la rentrée avec impatience. Au fond à l’école j’avais le sentiment d’exister pleinement, un sentiment qui m’était difficile à éprouver à la maison. Je m’y sentais (bien sûr je n’en avais pas alors une pleine conscience) complètement coincé avec très peu d’espace entre : un père autoritaire et, comme on dirait aujourd’hui, « patriarcal » (malgré son discours anarchiste, il avait eu très peu d’estime pour le mouvement de « fils à papa » de mai 68 et se sentait alors gaulliste) qui prenait beaucoup de place par sa corpulence, sa grosse voix et ses colères imprévisibles (il ne m’a jamais frappé, mais je crois que j’en avais très peur) ; une mère accaparée par les tâches domestiques et surtout par mon frère handicapé et à laquelle j’avais difficilement accès ; un frère, précisément, qui à partir de ma scolarisation perçut tout l’intérêt qu’il y avait pour lui à ce que je ne sois pas à la maison (le monopole sur l’attention de ma mère) et qui faisait en permanence des crises terribles pour que je déguerpisse. Dans ces conditions, l’école c’était tout simplement pour moi la vie.
Ca vaut ce que ça vaut, mais voilà ce que l’on trouve sur Wikipédia comme caractéristiques des enfants dits surdoués :
- Curiosité et soif d’apprendre, pose beaucoup de questions, capable d’acquérir des connaissances par ses propres moyens
- Perfectionnisme, besoin profond de bien faire avec exactitude
- Peu d’estime en lui à cause des difficultés rencontrées
- Peur de lui-même, de ce qu’il est, des conséquences de ses pensées et émotions débordantes
- Conscience méta-cognitive (savent identifier et réutiliser des concepts et des stratégies qu’ils emploient pour résoudre des problèmes)
- Intérêt, atteignant parfois un niveau obsessionnel, pour certains sujets
- Apprentissage précoce de la lecture, parfois sans aide extérieure
- Apprentissage précoce de la géographie (vers 8 ans), avec localisation de tous les pays du monde, et mémorisation des capitales
- Apprentissage précoce des grands événements de l’histoire
- Hypersensibilité (souvent invisible de l’extérieur, voir dyssynchronie interne)
- Altruisme, besoin intime d’aider les autres (qui les pousse parfois vers les professions du domaine de la santé ou de la justice)
- Tempérament solitaire, tendance à somatiser face aux incompréhensions et aux difficultés
- Langage soutenu qu’il adoptera au cours de sa propre éducation
- Sens de la justice
- Supporte difficilement l’échec
- Grande capacité d’attention
- Maturité intellectuelle supérieure à celle des enfants de leur âge (dyssynchronie externe)
- Affectivité et/ou développement psychomoteur parfois en décalage avec la maturité intellectuelle (difficultés en écriture, difficulté de diction) : dyssynchronie interne
- Sens de l’humour (notamment l’ironie)
- Sensibilité à l’harmonie (musique, esthétique)
- Capacité de mémorisation importante
- Capacité à suivre une conversation ou un exposé en faisant autre chose
- Très grande facilité à justifier ses comportements a posteriori
- Difficulté à prendre des décisions si confronté à un problème ne pouvant être résolu uniquement par la logique (ex : problème sentimental, émotionnel)
Vie relationnelle
La vie relationnelle dépend avant tout du contexte et aucune généralité ne saurait être parfaitement exacte. L’épanouissement émotionnel et l’intégration sociale de l’enfant dépendront en grande partie des acteurs avec qui il sera en relation, notamment les autres enfants. Cependant, la sensation permanente de ne pas être dans la norme, d’être considéré comme quelqu’un de « bizarre », les difficultés d’intégration dans les groupes, et l’alternance de périodes où ils suscitent l’intérêt (leur génie devenant une attraction, provoquant l’admiration) et du rejet (à cause de leur côté « bizarre », de leur difficulté de socialisation), provoquent souvent des difficultés dans la construction de la personnalité de l’enfant surdoué, ce qui se caractérise souvent par une difficulté à prendre des décisions (notamment celles ne faisant pas appel à un raisonnement logique, mais subjectif) ou parfois par un intérêt prononcé pour les expériences « extrêmes ».
Je me reconnais assez bien dans ces caractéristiques, à l’exception des difficultés de socialisation. J’ai toujours eu plein de copains à l’école et dans la rue où j’aimais jouer au ballon avec les autres gamins de ma cité. Ceci dit je crois que j’ai toujours apprécié dans mes relations une certaine originalité voire excentricité. J’avais plutôt tendance à fréquenter les derniers rangs de la classe où l’on trouvait, forcément, les gens les plus « cools ». J’aimais particulièrement A, l’ami corse que j’ai évoqué précédemment, dont l’inventivité et la créativité dans les jeux me fascinaient complètement. J’aimais aussi beaucoup mes amis comoriens et leur famille voisins du dessus dans mon HLM, d’une infinie gentillesse, qui me fascinaient eux je crois par leur différence radicale à tout ce que je connaissais par ailleurs tout en ressentant pour eux (mes mots d’aujourd’hui bien sûr) un profond sentiment de communauté pour tout ce qu’il y a de plus universel dans la nature humaine.
Il y a notamment du vrai dans le « peu d’estime en lui et peur de lui-même ». Pas complètement, bien sûr, je devais avoir une certaine conscience de mes capacités intellectuelles de par ce que m’en disaient mes parents et surtout par mes résultats scolaires, et par certains côtés j’avais probablement une certaine assurance. Cette assurance était bien sûr aussi nourrie tout simplement et en premier lieu par tout l’amour que j’ai reçu, car de l’amour je n’en ai pas manqué durant les première années de ma vie, c’est indiscutable, et naturellement il fut réciproque.
Mais cet amour manquait souvent du plus élémentaire – mais c’est peut-être plus facile à dire a posteriori qu’à faire – sens de la pédagogie, en particulier chez mon père. Après un premier enfant mort-né, puis un second lourdement polyhandicapé, j’ai dû être (douze ans plus tard, ils ne voulaient plus d’enfants) pour mes parents une immense source de joie (celle d’avoir un enfant enfin « normal »), mais aussi de fierté à me voir manifestement doué intellectuellement. Évidemment je ne dis pas qu’ils auraient dû m’élever comme si j’étais le messie et me couvrir en permanence d’éloges et de compliments au moindre petit exploit – et à leur décharge je pense qu’ils ne savaient pas très bien comment « gérer » un enfant comme moi, pas si « normal » que ça après tout (j’étais probablement pour eux, comme ils me l’ont parfois dit d’ailleurs, un peu un « extra-terrestre ») – mais le moins que l’on puisse dire c’est qu’il n’y a pas eu grand-chose dans mon éducation à la maison pour développer mon estime de moi-même, potentiel talon d’Achille (avec l’hyper-sensibilité) de mon type de personnalité…
Bande-son : « Fever » interprété par Rita Morena et Animal… des Muppets. Ce show était l’un de mes favoris enfant, et j’en garde de très beaux souvenirs de le regarder en famille au complet. Animal, déjà très grunge et décalé, était clairement mon personnage préféré ! J’apprécie aujourd’hui son goût pour les duos avec des femmes de caractère…
5.
J’ai peut-être une mémoire sélective, et je suis peut-être injuste à l’égard de mes parents, mais je ne me souviens pas que, mes bonnes notes une fois obtenues, ils m’aient particulièrement félicité, avec cette impression générale qu’ils me donnaient que c’était « normal », alors que je me souviens très bien que les plus moyennes, souvent dans des matières secondaires, m’étaient largement reprochées.
Lorsqu’on nous emmena à l’école la première fois à la piscine pour apprendre à nager, je me souviens d’avoir été terrifié par l’atmosphère générale brutale de cette piscine qui puait la javel et en particulier de plonger dans l’eau glaciale d’une hauteur qui me semblait vertigineuse. J’avais peur de l’eau et j’en fis même une réaction cutanée qui me valut une dispense du dermatologue, et je restais à partir de ce moment-là lors des séances au bord de la piscine pendant que mes petits camarades apprenaient à nager, un peu comme un handicapé (mon ressenti d’alors). Cette dispense était à l’évidence une mauvaise idée au plan pédagogique. Mais pourquoi mon père, qui nageait très bien, ne m’a pas appris à nager ? L’été nous allions ensemble à la plage et pendant que je restais au bord à faire des pâtés de sable je le voyais nager au loin de son puissant crawl, sans guère se soucier de m’éduquer à la natation. J’en ai ressenti un sentiment profond de nullité absolue.
A Noël une année on m’offrit un beau vélo. J’en faisais avec plaisir avec les petites roues de sécurité à l’arrière. Et puis mes parents se mirent en tête de m’apprendre à en faire vraiment et ce fut le début d’un véritable cauchemar qui dura je crois assez longtemps. Typiquement ça se passait le week-end lorsque nous allions pique-niquer à la campagne. Leur (drôle) de méthode consistait à me tenir fermement, mon père d’un côté, ma mère de l’autre : évidemment ça ne pouvait guère fonctionner. Leur acharnement et leur visible consternation (mon père disait notamment que j’étais « tout tordu », « bossu ») étaient vraiment très pénibles et humiliants avec encore une fois le sentiment d’être un handicapé physique. Et puis un beau jour dans un square, alors que mon père était assis sur un banc, je pris enfin mon envol sur mon petit vélo et ce fut l’un des plus beaux moments de mon enfance. Mais là aussi je ne me souviens vraiment pas que l’évènement ait été particulièrement célébré par mes parents, je n’avais que très laborieusement fait quelque chose de normal pour tout le monde.
Vers l’âge de huit ans mon père m’acheta un jeu d’échecs et se mit à jouer avec moi. Très bien. Au début, évidemment, il me battait à plate couture et nos relations étaient des plus cordiales. Et puis au bout de quelques parties, pas bien nombreuses, c’est moi qui l’ai mis mat. Évidemment je n’ai pas caché ma joie et me souviens d’avoir couru voir ma mère pour lui annoncer la nouvelle de ma victoire sur mon père. Avais-je cherché à « tuer mon père » comme diraient des psychanalystes bon marché ? Je crois que ma joie était bien innocente et compréhensible, et il aurait dû tirer quelque fierté à l’égard de son fils décidemment pas con. Mais il en fut profondément vexé, et refusa à partir de ce moment-là de jouer avec moi, prétextant toujours des maux de tête lorsque je lui demandais de jouer avec moi. Pourquoi ne m’a-t-il pas inscrit dans un club d’échecs pour développer ce petit talent ? Il en avait parfaitement les moyens financiers. A la place, et certes cela partait probablement d’un bon sentiment, il m’offrit un jeu d’échecs électronique. Mais jouer tout seul dans mon coin avec une machine ça ne m’amusait guère et je n’y ai que très peu joué.
Mon père disait aussi en me voyant dessiner que j’avais un bon coup de crayon mais que j’étais « fainéant ». Pourquoi au lieu de me rabaisser par ce faux compliment, ne m’a-t-il pas inscrit comme un de mes petits camarades de classe arménien à un cours de dessin pour développer cette aptitude ? Encore une fois il en avait parfaitement les moyens financiers. Il se mit lui-même à dessiner et à peindre, pourquoi n’a-t-il jamais cherché à m’apprendre ? De manière générale, ni ma mère, ni mon père n’ont jamais cherché à m’apprendre quoi que ce soit – ça aurait pu être des choses manuelles d’ailleurs – déléguant intégralement à l’école le soin de m’apprendre des choses.
Je me souviens aussi que mon père m’offrit des cassettes pour apprendre l’anglais. Là aussi très bien sur le principe. C’était une méthode du genre « repeat after me ». Mon père ne trouva rien de mieux à faire qu’à s’esclaffer en m’entendant répéter mes premiers mots en me disant que je parlais anglais avec l’accent marseillais. Ceci eut pour effet encore une fois un profond sentiment de nullité et j’ai très longtemps gardé cette idée que j’étais intrinsèquement nul en anglais.
Lorsque j’eu mon premier argent de poche, mon réflexe fut d’épargner, en nourrissant une tirelire en papier que je m’étais confectionné. C’était un réflexe qui me semble précocement sage, là où les enfants sont plutôt naturellement dans le plaisir immédiat. Cela me valut de la part de mon père d’être ridiculisé comme « l’avare de Molière ». J’en fus profondément blessé et me suis empressé de claquer mes modestes économies. Sur ce point particulier, une bien mauvaise éducation.
Et tout était un peu comme ça à la maison. Sans doute, étant par nature hypersensible, ai-je particulièrement et exagérément sur-réagi émotionnellement. Peut-être, toi qui me lis, trouveras-tu puériles ces récriminations à l’égard de l’éducation de mes parents. J’éprouve moi-même une relative culpabilité à étaler ce que je perçois comme des déficiences pédagogiques, là où dans l’ensemble je ne doute pas un seul instant que mes parents se sont efforcés de faire de bonne foi du mieux possible avec les moyens financiers, culturels et humains dont ils disposaient. J’ai d’ailleurs longtemps éprouvé une certaine culpabilité – jusqu’à mes trente ans et ma première psychothérapie – à m’être senti bien ingratement un peu malheureux parfois à la maison, alors que comme mes parents me le rappelaient souvent je ne j’avais jamais manqué de rien et que j’avais toujours eu notamment de nombreux cadeaux, preuves tangibles (et par conséquent indiscutables) d’amour.
Certes, comme tout enfant, je n’étais pas insensible à ces fameux cadeaux. Mais j’ai grandi dans une cité où mes copains n’avaient vraiment pas grand-chose et ils ne risquaient pas de me donner des envies matérielles. Le seul caprice que je fis pendant l’enfance, vers l’âge de trois ans, fut d’avoir un cheval à bascule, car j’en avais vu un dans la cage d’escalier auquel jouait le fils de la femme de ménage (mon cher grand-père paternel s’empressa de m’en trouver un dans la journée). Mais au fond, de par ma nature, mes besoins fondamentaux de reconnaissance étaient ailleurs et nettement plus spirituels. D’ailleurs plus grand j’ai eu tendance à soit sur-réagir positivement lorsque j’obtenais enfin cette reconnaissance intellectuelle, soit aussi à ne pas savoir qu’en faire car je n’y étais pas habitué.
En lisant mon manuscrit un vieil et cher ami, JP, qui reviendra dans la suite du récit, m’a appris ce beau proverbe juif : « On ne peut donner que deux choses à ses enfants : des racines et des ailes. »
Pour ce qui est des racines, je crois pouvoir dire aujourd’hui qu’ils m’en ont bel et bien donné et des profondes, et je crois des belles. Fils et petits-fils d’exilés, ayant grandi dans une cité qui fut rasée, ces racines n’étaient pas évidentes à percevoir et ce n’est peut-être qu’aujourd’hui seulement – en écrivant tout ceci – que j’en prends pleinement conscience avec la plus profonde des gratitudes à leur égard.
Quant aux ailes c’est plus complexe. A l’évocation de ma douance – et des difficultés et frustrations qui lui sont associées – ce même JP m’a très gentiment rappelé ce poème de Baudelaire, dans les Fleurs du Mal, l’Albatros :
Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers.
À peine les ont-ils déposés sur les planches,
Que ces rois de l’azur, maladroits et honteux,
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches
Comme des avirons traîner à côté d’eux.
Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule !
Lui, naguère si beau, qu’il est comique et laid !
L’un agace son bec avec un brûle-gueule,
L’autre mime, en boitant, l’infirme qui volait !
Le Poète est semblable au prince des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l’archer ;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l’empêchent de marcher.
C’est décidément bien gentiment que mon ami m’a rappelé ce poème en pensant à moi. Il me parle bien-sûr ce poème, sur les affres de la douance, mais je ne suis pas poète et je ne sais pas si j’ai, ou souhaite, des ailes de géant. De belles ailes d’hirondelle – agiles, joyeuses et migratrices – me conviendraient parfaitement. Elles restent peut-être encore à être pleinement déployées, et mon travail d’éducation à pourtant cinquante ans – grand enfant ? adulescent ? – me semble encore à achever. De fait les ailes qu’on me donne dans l’enfance me semblent plutôt serties de plombs : certes pas des gros plombs aux dommages irréversibles des fusils mitrailleurs, plutôt deux des carabines à plomb… qu’on enlève délicatement – peut-être sur toute une vie – avec des pincettes.
Bande-son : L’inquiétant poème symphonique écrit par Modeste Moussorgski, Une Nuit sur le Mont Chauve, qui faisait partie du paysage musical de mon enfance, et dont la noirceur fait écho à la mienne (note : revoir Fantasia de Disney).
6.
J’ai grandi dans une atmosphère générale d’athéisme et d’anticléricalisme, ce qui est tout à fait compréhensible et prévisible dans un foyer de Républicains espagnols : l’Église catholique espagnole s’étant très largement ralliée au camp adverse franquiste pendant la guerre civile, un ralliement d’ailleurs cohérent avec son alignement depuis toujours, au fond, du côté des riches et des puissants (je ne pense pas d’ailleurs que l’Espagne soit une exception). Mais cet athéisme était loin d’être radical et Dieu n’était pas complètement « mort » à la maison, pour reprendre la formule de Nietzsche : on trouvait bien en vue dans la bibliothèque une Bible, dans une édition protestante (à proximité immédiate du Manifeste du Parti Communiste de Karl Marx et Friedrich Engels, du Petit Livre Rouge de Mao et de Don Quichotte, l’autre « Bible » familiale), ainsi que quelques reproductions de tableaux religieux espagnols et des Vierges miniatures. Et puis à Noël nous faisions la crèche, avec des santons provençaux que mon père avait patiemment peints à la main : je me souviens d’avoir candidement questionné mon père une fois sur la cohérence idéologique de cette crèche… sans avoir obtenu je crois de réponse très convaincante. Première expérience théologique.
Et puis surtout mes parents voulurent, en bas âge, me faire baptiser, parce que c’était je suppose la tradition au même titre que de se marier à l’église. Une grand-mère étant en phase terminale de son cancer et avec mon frère handicapé, ils s’étaient mis en tête d’avoir un baptême « privé » en petit comité et avaient déjà tout organisé (date, petit habit blanc pour moi et dragées). Évidemment ils avaient oublié quelque chose de crucial dans leur planification : le curé. Mes parents ne fréquentaient absolument pas la paroisse du quartier et lorsque mon père entra dans l’église pour la première fois il découvrit le curé en train de vociférer des réprimandes à des parents pour la mauvaise éducation catholique donnée à leurs enfants : ça commençait mal. Ensuite le curé ne voulut rien savoir du baptême privé à la bonne franquette, et insista pour que mon baptême se fit avec tous les autres enfants en grande pompe. Il voulait aussi faire promettre par mon père que j’irais au catéchisme et à l’église le dimanche… Tout ceci était parfaitement inacceptable pour mon père et après un dialogue de sourds qui dut être fort intéressant ils se mirent finalement d’accord sur un point : je me baptiserais une fois adulte si jamais je devais le souhaiter un jour sur la base de mon seul et souverain libre-arbitre.
Vers l’âge de huit ans j’ai demandé, avec un certain enthousiasme, à mes parents d’être baptisé… mon père refusa catégoriquement arguant (décidément une drôle d’idée, je me demande où est-ce qu’il était allé chercher ça) que je ne le voulais que pour recevoir des cadeaux (à la communion je suppose). Je ne me souviens pas vraiment de mes motivations d’alors – envie d’être baptisé comme certains de mes copains ? envie de faire partie d’une communauté ? petite crise mystique ? appel ? œuvre du Saint-Esprit ? – mais toujours est-il que je pense pouvoir affirmer qu’elles n’avaient strictement rien de bassement matérialistes. Je crois que toute cette petite histoire de baptême raté et éventuellement reporté m’a profondément marqué – et j’y reviendrai plus tard dans mon récit.
Mais je ne peux achever cette évocation de mes douze premières années dans ma cité HLM en restant sur cette énième bizarrerie de mon père à mon égard. Sans vouloir faire de la psychanalyse à deux pesetas, il me semble raisonnable de penser que toute relation père-fils (ou mère-fille) est après tout complexe : en l’occurrence, entre d’un côté un pater familias, manquant parfois de pédagogie et peut-être aussi d’estime en lui-même (difficile en ce cas de la transmettre), et de l’autre un enfant par nature hypersensible (voire exagérément susceptible) et doutant facilement de lui-même, les incompréhensions et les malentendus étaient sans doute inévitables. Pour autant mon père et moi nous nous sommes profondément aimés et il y eut, fort heureusement, de multiples occasions où cet amour de part et d’autre fut manifeste.
Je garde notamment de très beaux souvenirs de nos promenades ensemble le dimanche (mon frère, le grand-père, ou mon ami A nous accompagnaient parfois) au port autonome de Marseille (avec ses cargos du monde entier ou ses navires de guerre américains, nettement plus romantiques que les bateaux de croisière d’aujourd’hui), au Palais du Pharo, au Musée Longchamp. Je me souviens aussi de notre collection de timbres constituée sur le pittoresque marché philatélique de Marseille (qui me fit voyager dans le monde entier et dans le temps), celle aussi de minéraux et de fossiles (mon père avait au fond un certain goût pour les cabinets de curiosités) ou d’avoir joué avec lui au train électrique (il en avait construit un pour moi très élaboré qui occupait toute une petite pièce de notre appartement). De nos sorties au cinéma qui étaient pour moi absolument magiques (des Disney, mais aussi des films comme Star Wars, E.T. ou la Guerre du Feu), et c’est toujours avec cette sensation de magie que je pénètre dans une salle obscure (et que je me prends une glace, en souvenir de celles que mon père m’offrait). Et nous avons beaucoup ri ensemble en écoutant ses disques de Coluche (excellente éducation politique).
Mon père n’était peut-être pas un très grand pédagogue dans l’absolu mais il s’est quand même efforcé de me nourrir intellectuellement, par des jeux éducatifs notamment (par-dessus tout des Légos, que j’eu en abondance), des cahiers de vacances (que je détestais) et puis surtout par des livres… quitte à ce que je me débrouille tout seul avec eux. J’ai lu les divertissantes aventures de Mickey et de tous ses petits copains, mais je ne crois pas qu’elles ont eu sur moi un grand impact sur le long terme : il y a sans doute largement de quoi faire une analyse idéologique critique de Disney en tant que promoteur d’une certaine American way of life, je pense surtout que les causes défendues par ses héros et les méchants auxquels ils s’attaquent manquent singulièrement d’envergure. Plus intéressant, mon père m’a aussi fourni en Lucky Luke, et je garde toujours une certaine tendresse pour ce justicier solitaire (fumeur) et son seul véritable ami Jolly Jumper.
Mais surtout il m’a nourri par la collection complète des aventures de Tintin : des enjeux (et par conséquent des méchants) de bien plus grande envergure, notamment géopolitiques (Tintin chez les Soviets et Tintin chez les Picaros, dénonciations des dictatures de gauche comme de droite, sont mes préférés). Là aussi je me garderai de psychanalyser Tintin comme on le fait trop souvent, à mon sens de manière capilotractée, mais il probable que cette image d’un héros grand reporter, aux amitiés les plus diverses, et qui ne s’embarrasse pas de femmes et d’enfants (contrairement à Mickey, peut-on imaginer Tintin en bon père de famille, avec le crédit hypothécaire qui va généralement avec ?) a dû exercer une certaine influence…
Mon père a aussi mis entre mes mains de « vrais » livres : entre autres, les fables de La Fontaine, les contes de Grimm et de Perrault, les Mille et Une Nuits, des Jules Verne, Alexandre Dumas et Agatha Christie. Et puis par-dessus tous ces livres, il y avait les Voyages de Gulliver de Jonathan Swift, dans une jolie édition abrégée pour enfant, qui exerça sur moi une profonde fascination sans trop savoir alors pourquoi : il y avait de quoi, ce n’est assurément pas un livre pour enfant comme on le croit trop souvent, mais bien un complexe (et subversif) conte philosophique, que je redécouvrirai bien plus tard lorsque je me suis intéressé de près aux utopies et dystopies littéraires et politiques.
Pour le reste j’étais un enfant comme tous les autres dans ma cité (avec peut-être pour signe de distinction de porter parfois des polos Lacoste comme mon père, un signe extérieur de richesse pour les standards du quartier). J’aime jouer au foot dans la rue, avec certainement nettement moins de douance footballistique que Zinédine Zidane qui grandit au même moment dans une cité voisine, La Castellane. Je suis avec ferveur l’épopée des « Minots » – ces jeunes issus du centre de formation qui remplacent les stars surpayées qui ont échoué – qui sauvent en 1981 in extremis l’Olympique de Marseille de la faillite et assureront sa remontée en D1 quelques années plus tard, ainsi que les équipes d’Espagne (qui nous désespère par sa médiocrité) et de France (héroïque) au Mondial organisé en Espagne en 1982 (je collectionne les autocollants Panini de la compétition et réussit l’exploit de les avoir tous). Et puis je joue aussi toujours dans la rue (pas sur un court) au tennis (dans sa version prolétaire, avec des raquettes en mauvais plastique et des balles en mousse). Je n’ai jamais été très sportif mais mes parents ont fait des efforts louables pour me donner une éducation sportive. Ils m’ont notamment inscrit au judo : mais je me fis rapidement une douloureuse fêlure de la clavicule suite à une mauvaise chute et je ne voulus plus jamais y retourner, mes parents n’insistant pas ce qui était assez compréhensif de leur part. C’est dommage, ça aurait pu être une bonne école de formation du caractère, mais je crois que je n’ai jamais aimé me battre, même de manière civilisée comme au judo, avec une aversion viscérale pour toute forme de violence.
Je me souviens très bien que ma mère eut alors l’idée de m’inscrire à la danse : je ne crois pas que cela souleva en moi un quelconque enthousiasme (je crois que je trouvais ça un peu bizarre comme activité pour un garçon, même si je me souviens d’avoir improvisé une fois une petite chorégraphie très « danse contemporaine » qui enchanta mon institutrice) et cela n’eut pas de suite, mais je crois rétrospectivement que c’était vraiment une brillante idée. Je suis convaincu que les écoles seraient autrement plus joyeuses et pacifiques si l’on y enseignait cette compétence tout à fait essentielle, tant au plan corporel que social. Certains grands éducateurs (comme le britannique Robert Owen, visionnaire entrepreneur social et pionnier du socialisme) ne s’y sont pas trompés et la grande figure anarchiste américaine Emma Goldman dira même : « If I can’t dance I don’t want to be part of your revolution » (Si je ne peux pas y danser, je ne veux pas faire partie de votre révolution »).
J’ai aussi abondamment consommé les divers divertissements télévisuels pour enfants caractéristiques de mon époque, de plus ou moins bonne qualité… Mentions spéciales rétrospectivement pour Rue Sésame, le Muppet Show, et l’émission culte de science-fiction Temps X des frères Bogdanoff, que je trouve alors absolument géniale… Le Manège Enchanté ou le cirque (surtout les clowns) me plongent, en revanche, dans une profonde mélancolie.
J’ai grandi dans ma cité dans un environnement extrêmement urbain avec peu de contact avec la nature. Nous avions néanmoins dans l’appartement un fort bel aquarium avec des poissons exotiques tout à fait captivants et une volière remplie de perruches multicolores. A ce sujet une petite anecdote qui me marqua. Mes parents achetèrent deux perruches : le mâle, visiblement très « amoureux » de sa compagne de captivité, se vit systématiquement et énergiquement rejeté par celle-ci dans ses avances. Il tomba rapidement gravement malade (à mon sens de chagrin) et malgré les soins de mes parents (des bains de vapeur, drôle de thérapie, qui l’achevèrent) mourut. Il fut remplacé par un autre mâle, dont la femelle tomba ce coup-ci éperdument amoureuse et ils eurent un nombre incalculable d’enfants que l’on donnait dans le voisinage. Je raconte cette histoire car je crois que c’est là que je me rendis compte pour la première fois que les animaux sont loin d’être des machines toutes identiques au sein d’une espèce, et ont – à leur façon, mais résolument – une personnalité, une intelligence et des sentiments.
J’ai très peu de souvenirs des évènements politiques de cette époque. A l’exception de l’élection de François Mitterrand, avec la petite animation qui annonça sa victoire à l’écran, pour la plus grande joie de mes parents (avec surtout la promesse, tenue celle-là, d’une retraite à 60 ans, salvatrice pour mon père qui n’aurais jamais tenu le coup physiquement jusqu’à 65 ans) et des instituteurs de mon école. A l’exception aussi, et surtout, de la mort de Franco en 1975, après plus de trente ans de dictature durant lesquels aucun membre de ma famille ne mis les pieds en Espagne. Cette mort fut célébrée, comme le fit je crois toute la communauté de réfugiés politiques espagnols, par une bonne bouteille de champagne, qui traina longtemps dans le frigo (« quand allait-il donc mourir ? » s’impatientaient mes parents) du fait de la longue (et bien méritée aux yeux de ma famille) agonie du dictateur.
Cet évènement eu pour conséquence pratique pour nous de passer quelques vacances d’été en famille en Espagne : nous avions bien sillonné le pays mais je garde hélas assez peu de souvenirs, hormis quelques châteaux-forts et des villages d’un blanc immaculé (mes parents préféraient visiter l’Espagne profonde et fuyaient la côte, trop touristique à leur goût, excellent pour le coup), des routes défoncées sillonnées par les Renault de mon père (prolétaire R6, sportive R12, embourgeoisée R18), de la succulente cuisine au restaurant (découverte pour moi), des moulins à vent et des troupeaux de moutons sur les plaines de La Mancha exactement comme dans Don Quichotte, et une famille (essentiellement dans le village de ma mère) très chaleureuse et accueillante (on ne parlait jamais politique, sujet qui peut fâcher, tous n’étaient pas en effet du même bord) pour qui j’étais avec une certaine curiosité attendrie le « petit cousin français »… souvenirs aussi (comment les oublier ceux-là) d’avoir joué pendant ces vacances espagnoles de mon exotisme relatif pour expérimenter mes premiers flirts… rien de très « concluant » à vrai dire, mais suffisamment intriguant pour ne pas complètement vouloir m’identifier à mon héros Tintin…
Bande-son : j’aurais pu choisir l’excellent African Reggae de Nina Hagen : mon père avait constitué une collection de vinyles des plus éclectiques, et j’ai grandi habitué à un paysage musical très varié (allant du classique et du jazz, parfois assez savants, à la variété, en passant par des chants folkloriques, les musiques du monde, de films, la chanson à texte, le disco, le reggae, et même de la musique militaire… y compris franquiste !), mais n’en revenais tout de même pas enfant de voir mon père apprécier cette musique punk-gothique berlinoise aussi déjantée.
Je choisis pourtant, de manière complètement anachronique, la chanson « If I can’t dance » de Sophie Ellis-Bextor qui, sous des airs de british pop-dance acidulée et parfaitement inoffensive, reprend avec des paroles très intelligentes la citation d’Emma Goldman… chanson sur laquelle je suis tombé par pure sérendipité – un heureux hasard – en écrivant cet épisode. J’en fais volontiers mon hymne révolutionnaire personnel : je suis en effet convaincu que le jour où la révolution sociale apparaîtra au peuple de manière aussi sexy et désirable, ceux du capitalisme seront comptés.